frédéric Guionnet, 2 (écriture)

ERRANCE CHOUETTE


"JE SERAI DOUCE "

septembre
A la fin de la nuit, sans aucun bruit, elle a quitté la pose dans laquelle, depuis deux mois, des milliers de citadins l'avaient admirée. Alors que je me tenais sur un banc du jardin, dans l’ombre presque noire, je l'ai vue tout à coup se mettre en mouvement. Mais plutôt que de s' extraire péniblement de son sommeil de pierre, et même plus gaillardement que nous ne sortons de nos nuits, elle m'a donné l'impression de reprendre tranquillement son chemin, comme si elle ne s'était arrêtée qu'un instant, dans sa temporalité monumentale. Alors elle est sortie du petit jardin, le front balayé au passage par les feuillages du vieux tilleul, faisant s’envoler un couple de pigeons et elle a traversé le village endormi des caravanes et des manèges, installé comme à chaque fin d’été sous les platanes du Cours Saint Pierre. Puis elle a descendu le large escalier qui borde l’esplanade vers le sud. Je me suis assis sur la plus haute marche et je l’ai regardée s'éloigner à travers le quartier moderne qui cerne la ville. A-t-elle emprunté les ponts ou simplement traversé le fleuve comme j’aurais traversé un ruisseau ? De temps en temps, entre deux tours bleues, j’apercevais sa silhouette gigantesque et transparente. Je revins au jardin déserté. Là où elle s’était tenue tout l’été et où je venais d’assister à son départ solitaire, nulle fleur d'écrasée, nul brin d’herbe de foulé, nulle empreinte de pas ne creusait le sable où elle avait marché, comme si elle avait été plus légère qu’un nuage, plus légère qu’un rêve.
octobre
"Pourtant pourtant c’est bien elle", me disais-je alors que je marchais le long de la rivière sous de gigantesques platanes, de plus en plus sûr mais aussi de plus en plus surpris, en me rapprochant, de reconnaître la silhouette de celle que je croyais enfuie. La rivière à cet endroit, bien qu’elle traverse encore la très proche banlieue, s’ensauvage brusquement. Ses rives se couvrent d’arbres qu’on dirait poussiéreux, de cette poussière de temps et d’ennui qui règne sur les grands fleuves tropicaux et que ne remue nul courant, nulle navigation. Mais au-dessus de ces cimes déteintes, par ci par là des cheminées de brique, deux, trois, se dressent frêlement dans le ciel verdâtre, comme l' ultime et fragile souvenir d’une époque révolue et d’une ville disparue. C’ était donc ici, sous les monstrueux platanes, qu’elle s’était arrêtée, sous cet ombrage à sa mesure! Se repose-t-elle un instant, me suis-je demandé, se retourne-t-elle vers des lieux qu’elle a quittés à peine, dans son temps de géante, pour les contempler une dernière fois avant de les oublier, avant de remonter vers la source, vers sa source ? Et quelle est-elle, cette source ? Est-ce le mystère dont elle sort ou qu’elle est, aussi somptueusement, me demandais-je encore, assis à ses pieds de basalte, est-ce cette inspiration qui naît tout à coup de l'enui ou de la rêverie, comme un ruisseau du flanc d’une colline, et que les vieux poètes appelaient muse ? Muse dont le plus gracieux a dit avec raison et folie qu'elle "est un oiseau qui passe". Il me sembla, assis là, adossé familièrement contre son mollet, sous les énormes cuisses, sous le ventre de pierre que, très doucement, elle avait respiré; une onde presque imperceptible l'avait parcourue. Peut-être n’était-ce qu’un peu de vent. De l’air tiède traînait des graines ailées à la surface de la rivière, faisant par moment frissonner les feuillages. Mais les branches énormes qui serpentaient au-dessus de ma tête comme des boas mythologiques, les troncs gros comme des pattes d’éléphants monstrueux n’avaient pas frémi. Traversant l’immense feuillage, un éclat de soleil touchait le pied de la géante. J'y posai la main, caressant la pierre grise, et le trouvai aussi chaud que celui d’une vivante.
novembre
On en parle encore de temps en temps mais le cœur n’y est plus. L’excitation et la curiosité sont bien retombées et d’autres événements, tragiquement plus tragiques, ont fait passer cette affaire au second plan des journaux et des esprits. L’ enquête se poursuit, ainsi que j'ai pu le lire quand même récemment. Le milieu artistique a été investigué et on a soupçonné un marchand d’art, en difficulté financière, mais il vient d'être mis hors de cause il y a peu. Une question autrement insoluble reste sans réponse: Comment un tel monument a-t-il pu disparaître en une nuit, alors qu' il a fallu une grue télescopique et quatre personnes pendant une semaine pour l'installer, tronçon après tronçon, des pieds jusqu'à la tête. Dans le même article, une femme, « habitant le quartier de longue date », dit l’avoir vue, comme chaque soir, lorsqu' elle est sortie avec son petit chien pour leur dernière promenade, autour de 21 heures. Après elle, personne ne peut témoigner de ce qui s'est passé jusqu'au lendemain, où vers 7 heures un autre riverain alerte la police de l’incroyable disparition. L'absence de la déesse de basalte ne pouvait lui échapper, puisque c'est à ses pieds qu'il a pris l'habitude, depuis qu'elle est là, de faire une séance d'assouplissement , avant de partir courir au bord de la rivière, comme tous les matins. "C’est court pour un tel déménagement, concluait l’article un peu narquois. - Oui mais les voleurs étaient bien organisés et particulièrement déterminés ", avait répondu le préfet . Pourtant, mon ami Ëljo - il trouve qu'à l'envers c'est« plus fun que Joël, plus manouche aussi", car il est musicien, et sa guitare a presque le charme de celle de Django - m’a dit quelque chose l’autre jour qui m'a laissé perplexe. C'est que lui, il est passé par là aussi, mais un peu avant 7 heures, l'heure du jogger matinal, et qu'à ce moment- là, " tiens-toi bien, la géante, elle était bel et bien là, tout tranquillou et tout". En fait, il avait été invité pas loin à une fête, m’a-t-il raconté, chez des amis, des gens qu’il avait connus il y a plusieurs années, quand il habitait le quartier. Sortant de chez eux fort tard dans la nuit, ou plutôt, « fort tôt le matin, 6 heures ou et demie », Il avait préféré marcher jusqu’à chez lui, de l’autre côté de la ville, ayant un peu trop bu pour conduire. Il avait été content de retrouver tous ces gens qu’il n’avait pas vus depuis longtemps mais qui se souvenaient de lui, gens du quartier, artistes débonnaires dont les œuvres n’étaient connues que d’eux-mêmes, artisans aux métiers perdus, serruriers, luthiers, et même un constructeur de barque, installé depuis toujours au bord de la rivière. Il faisait encore nuit, mais la géante, quand il avait rejoint le bord de l’eau, était bien là et même il l’avait "trouvée pas mal", ne l’ayant pas encore vue. Sa haute silhouette se dressait dans la nuit, sous les platanes immenses, toute noire, souveraine, avait-il trouvé, et il s’était arrêté un moment à ses pieds. Bien sûr, il n’avait pas jugé utile de témoigner devant "les autorités". "Qu’ils se débrouillent, profitons quant à nous et entre nous du délicieux mystère, a-t-il conclu, et puis tu sais, un témoignage aussi invraisemblable, émanant d’un faux tzigane aviné et noctambule, ça pèse pas lourd, moins lourd qu’une géante de sept mètres de haut en vraie pierre, même volcanique, et même moins lourd qu' un petit chien", et il a éclaté de rire. Tout compte fait, selon son lui, dix minutes un quart d’heure avaient suffi pour que disparaisse la géante douce. Quel magnifique mystère en effet, et mon ami qui est un poète sait protéger la beauté et la douceur du monde. Les journaux et les gens finiront par oublier. Hier soir tard, sur une chaîne d’info, un journaliste spécialisé dans les dossiers judiciaires, a évoqué l’affaire, à propos d’une tout autre histoire, celle du vol de la Joconde en 1911. Il a écorché le nom de l'artiste iranienne auteur de la sculpture, et fait une erreur sur le nom de la commune où s’était produite la disparition. L’oubli a donc déjà commencé son œuvre et c'est peut-être tant mieux. "Heureusement pour nous, disait le journaliste, on avait fini par retrouver la Gioconda et, en plus, en bon état."
On était bien avancé. Un amoureux de la géante a dû lui prendre la main sans un mot, me suis-je dit, peut-être même qu’il l’a emmenée dans sa Twingo vert pomme et qu’elle a kiffé l’air frais dans ses cheveux en traversant la Loire vitres ouvertes et maintenant ils vivent ensemble dans son petit studio. A Beaurivage, le socle de béton assez bas où elle s’était tenue l’espace d’un automne, au bord de la rivière sous les grands platanes, a déjà disparu, lui aussi, sous les feuilles mortes, rousses, rouges et brunes. Ce qui disparaît de notre vue disparaît de notre mémoire. Parfois je me demande si, comme je l’ai rêveusement imaginé cet été, elle ne s’est pas vraiment mise en route, en cette nuit d’octobre, pour de vrai.
hier
En début d’après midi, alors que nous finissions de déjeuner distraitement, fatigués de la chaleur et du repas copieux (gros poissons en sauces au vin blanc, lourdes et délicieuses), il se fit au dehors un grand bruit d’eau et de feuillages, comme si du vent -mais il n’y avait aucun vent- avait haineusement bousculé les roseaux et les saules qui bordent ou plutôt qui étouffent la rivière.
De cette véranda où nous étions, on ne domine que d’un mètre ou deux une vaste étendue de végétation souple où serpente un large méandre d'eau vert pâle. Peu d'arbres mais, surtout depuis quelques années, des roseaux et des bambous. Ils finiront, se dit-on un peu avec mélancolie, par tout envahir, par "avoir raison de tout". Les saules au feuillage argenté et mouvant semblent lutter contre les belles et fières colonies vertes des envahisseurs exotiques. Au milieu, sous un ciel souvent laiteux et chaud, la rivière évoque une coulée de jade, opaque et lente. Trois ou quatre maisons surgissent de cette végétation, sur chaque rive. Comme la nôtre, elles sont construites sur des pilotis, probablement pour échapper aux crues de cette rivière imprévisible. Mais on se dit plutôt que si ces constructions aux toits de tuiles et de tôle qui les font davantage ressembler à des abris ou à des granges provisoires qu'à de véritables maisons se dressent si disgracieusement au-dessus du feuillage envahissant , c’est pour échapper à l' emprise végétale, c'est afin de ne pas succomber à l'asphyxie. Alors que nous nous demandions quelle pouvait bien être la cause de cette agitation, un éclair fulgurant, doublé d'un monstrueux bruit de feraille nous épouvanta nous faisant croire une seconde qu'il nous déchirerait et les yeux et les oreilles. Une vapeur banche s'éleva en tournoyant comme un mini-cyclone du sein duquel apparut une structure, transparente comme du verre. Vite ses formes s'organisèrent pour former un immense cristal, un "icosaèdre!", m'exclamai-je immédiatement sans savoir d'où me venait cette subite inspiration, et bien que je ne susse point à quelle figure ce mot renvoyait mais dont la sonorité provenait sans doute de ce que je venais d'entendre, et même de ce que j'étais en train de voir. l'objet monta dans le ciel tandis qu' au même moment, à sa verticale, apparut une gigantesque femme nageant au milieu de la rivière. Sa chevelure blonde ondulait dans son dos et brillait comme de l’or. Elle ne nageait pas la brasse comme une sage baigneuse, mais un crawl lent et athlétique. Ses bras musculeux apparaissaient alternativement, dans un mouvement parfaitement régulier et tout son corps semblait onduler, entraînant à sa suite de profonds remous. Le battement lourd de ses pieds résonnait dans le silence, rappelant un peu celui des roues à aubes qui battent le Mississipi, au flanc des vieux navires de ferraille blanche. Elle occupait presque toute la largeur de la rivière et faisait se lever derrière elle une large vague, haute d'un mètre ou deux, déroulant en une longue traîne écumeuse ce qui me parut être la longue robe d’une déesse ou d'une reine sauvage et que semblaient saluer tout autour dans le remous provoqué, les touffes de roseau. La rivière se jette cinquante kilomètres plus bas, en un golfe sablonneux aux rives incertaines, et il ne fit aucun doute pour nous qui assistions médusés à ce spectacle magnifique et incompréhensible, que c’était vers ce but qu’elle nageait ainsi, pesamment, infatigablement, opiniatrement. Elle échappa à notre vue au point où le méandre, dans sa courbe, s'enfonce dans le moutonnement infini de la végétation. Ce qui me charma le plus, finalement, quand j’y repense, c’est le teint de ses bras, de ses épaules et de ses fesses sous la vague transparente qui naissait à son passage: un vert qui était celui-là même de la rivière, un vert d’eau - ou celui du bronze? - pâle et cendré, comme si cette femme eût été faite d’eau, de la même eau que la rivière qu’elle descendait, ou comme si, en exagérant un peu, elle eût été cette rivière elle-même.
Ce ne fut peut-être qu’un rêve, mais de toute cette histoire, cette dernière apparition me sembla marquer la véritable et inexorable conclusion ♦
(une histoire inspirée par une sculpture de l'artiste Sanam Khatibi, "je serai douce")
MÊME PAS LA GUEULE DE BOIS, novembre 2025

Ce matin la lune -demi-lune, plutôt- se balade à l'ouest, dans les cèdres, accompagnée de quelques étoiles fines, des copines sans doute. Mais hier soir elle se promenait de l'autre côté du ciel, vers la ville. Elle a donc passé toute la nuit dehors à faire la fête me suis-je dit, une fête sans bruit. Son foulard (de soie) traînait pas loin, au cas sans doute où il ferait un peu frais vers le matin, c'est vrai qu'on est en novembre, maintenant.
Tu m'étonnes en tout cas si une petite heure plus tard elle avait disparu, comme volatilisée dans le jour beu clair. Elle est partie se coucher la coquine, mais ce soir elle remet ça ♦
PLUIE ENCORE, LES GRENOUILLES RIENT
Pluie encore cette nuit, "flic flic" ,et encore ce matin les gouttes sonnent à nos rambardes, clochettes qui me consolent. Enfant, c'était le temps que j'aimais mieux en rentrant de l'école à midi et demie: "il pleut il mouille c'est la fête à la grenouille" ! j'étais content pour elle. Les cheveux tout mouillés vite essuyés, les betteraves au persil, la blanquette à maman, réchauffés séchés tout ébouriffés Pierre & moi à nouveau sous l'eau sous des capuches trouvées pour le tantôt les récré sous le préau.
De toutes celles dont je me rappelle pas une qui ne soit douce chanson: Pluie mouillée des bocages de Vendée serrant les troupeaux sous les haies ou dans les étables souillées d'où par les portails abandonnés s'écoulent des flaques odorantes, crachin sans fin (ni début) des soirs d'automne ou bien d'hiver où chantent en coins coins gais les canards des Poiraud et maman cousant disant qu'ils sont contents.
Ah! trève de regrets car la pluie toujours "est mon amie", que cela si possible soit dit sans mièvrerie.

Pluie de Nantes la pluvieuse la pleureuse jamais plus aimante qu'ainsi: Avenues boulevards rues ruelles en miroir d'eau, voitures bus faisant fchiiii, vélos en capuchons, trottoirs lavés aux trésors échoués: fleurs malmenées, feuilles arrachées en bouquet durement, faines ouvertes, samares égarés et sans descendance prévisible, doigts séparés des mains des bignonias, tout ça à adorer de sous le parapluie feuille de babanier moi chanter et les grenouilles rient ♦ février 2026
TORTUE LUTH


LE JARDIN DUMAINE ET MOI

Luçon, l’été, c’est bien calme. Allée Saint François, sous les arbres en arceaux il n’y a aucun bruit et on marche comme dans sa maison. Du mur du jardin Dumaine dépassent de grandes branches sombres. Des souvenirs de mon enfance y sont cachés. Les sons, les parfums, les décors me rappellent à chaque instant de délicieux plaisirs. Aujourd’hui encore ces sons, ces parfums et ces décors, tout aussi frémissants de charme, gravent dans ma mémoire de nouvelles images, peut-être dans d’autres couleurs.
Ce jardin a planté en moi de profondes racines. Profondes comme celles de ses vieux arbres fatigués, sous lesquels je m’arrête, lors de mes visites. Sans doute parce que mes souvenirs d’enfance y sont doux : promenades avec mes parents, mes sœurs, mon frère, et avec eux fêtes de nuit, fêtes des écoles, rencontres avec ces vieilles gens qui nous paraissaient si sages, et plus encore, souvenirs de ces souvenirs qui s’affinent ou s’érodent encore en moi, me laissant au fil du temps un parfum de plus en plus léger mais aussi de plus en plus subtil.
Ces souvenirs ont créé en moi un autre Jardin Dumaine, personnel, intérieur, très sentimental et qui embellit avec le temps. Quand je retrouve le vrai, c’est avec un mélange de plaisir et de surprise, parfois de déception. Néanmoins j’arrive, et c’est déjà un autre plaisir, à faire se superposer les deux jardins, le vrai et le rêvé. J’ai alors l’impression, instable, de marcher dans une réalité composée de deux registres, où l’un et l’autre échangent leurs partitions, me plongeant moi-même dans un temps où sont mêlés passé et présent, dans une réalité ambigüe, faite de rêve, de souvenirs et de conscience présente. Cheminant par les allées parfumées de laurier, j’ai alors de délicieux vertiges. J’en sors tout engourdi comme d’un film envoûtant ♦
LA LIGNE D'HORIZON

Du haut de la dune où elle se tient pour l’instant, ce n’est qu’une infime différence au loin, entre les nuages du matin qu’a laissés une nuit d’orage, et la mer, plus lumineuse. Puis tout autour jusqu’à elle il n’y a que le moutonnement sombre des pins.
Une envie la prend, atteindre la blancheur qui luit par delà la forêt, juste sous le gris du ciel. Elle disparaît alors dans le feuillage, éveillant les geais et les pies. La ligne d’horizon a laissé dans ses yeux une marque tenace, un éblouissement qui la guident dans l’ombre verte et l’odeur de résine mouillée. Mais la forêt n’a cessé de s’approfondir et de s’obscurcir que pour s’éclairer tout à coup comme un ciel qu’abandonne la nuée. La voici à nouveau devant la même ligne pâle, énigmatique, inaccessible. Pure image, se dit-elle, créée par sa présence sur le sable. En marchant vers l’eau elle se déshabille, laissant tomber ses vêtements derrière elle, l’un après l’autre. Elle rencontre enfin les premières eaux de la marée montante dans une complète nudité. Leur apparence lui suggère l’idée d’un escalier aux larges marches très finement superposées, montant vers le gonflement indistinct des flots. Mais elle, comme elle continue sa marche, plutôt qu’emprunter les marches cristallines, elle s’enfonce lentement sous la ligne d’horizon qui, d’immobile et lumineuse qu’elle était, s’assombrit, se hérisse de mille vaguelettes, et devient la courbe mouvante de la houle, l’entourant, la berçant, baignant son visage jusqu’à mi-hauteur, les yeux comme posés sur l’eau. Elle se dit qu’il est amusant qu’il lui suffise d’ouvrir un peu la bouche pour y faire entrer cet horizon qu’elle aperçut tout à l’heure, depuis les dunes boisées. Continuer sa marche la ferait disparaître de la surface du monde, comme se dissolvent les vagues. Mais elle sait qu’après le bain un autre plaisir viendra. Elle reviendra sur la plage, s’étendra sur le sable dans la clameur des flots vifs, seule, infiniment seule au bord de l’horizon ♦
ISOLINO MIO

" J’ai mis de gros souliers,
un cache-nez, un vieil imperméable;
j’ai pris un bâton et je suis parti. " (Marcel Arland ; La Consolation du voyageur)
Il faisait déjà presque nuit, et je commençais à fatiguer, ayant marché toute la journée. La petite route que j’avais suivie pendant toute l’après-midi avait fait place à un chemin de terre où les cailloux roulaient sous mes pieds. Il avait fait très sec tout l’été, mais depuis quelques jours, le ciel s’était chargé de nuages sombres qui s’amassaient au- dessus des champs. Leur ombre obscurcissait les maïs oubliés.
Si j’allais ainsi par les chemins depuis cinq jours c’est que, l’automne venu, j’avais eu envie, un peu mélancolique, de marcher seul jusqu’au petit village de Vendée où j’étais né, au fond du bocage.
Je n’y étais jamais revenu depuis que ma famille l’avait quitté quand je n’avais pas encore cinq ans. Quelques images décolorées m’en restaient, comme ce long mur de pierre grise au long duquel je me rappelais avoir donné la main à l’une de mes sœurs, ou peut-être à une jeune voisine, Louisette, Irène, ou … pour un départ en promenade printanière. J’aimais à me rappeler leurs naïfs prénoms. Je revoyais aussi le long troupeau de moutons passant tôt le matin devant la maison. Parfois le berger frappait à la porte pour nous montrer, sur ses épaules ou dans ses bras comme un enfant jésus, un agneau né de la nuit, avant de repartir vivement, rattrapant son troupeau, haute silhouette en capuchon gris sous l’averse au milieu des dos laineux. Et je remuais en moi ces doux souvenirs tout en marchant.
J’avais voulu parcourir lentement l’espace et le temps qui me séparaient d’eux, m’enfoncer lentement dans ce pays où j’espérais les retrouver. Je voulais les surprendre comme on surprend un bel oiseau en s’approchant sans bruit. Il me semblait que ce village devait garder en lui quelque chose, peut-être juste un parfum oublié, qui me ferait du bien.
Je n’avais emprunté que les chemins étroits, découvrant un autre paysage et presque un autre pays, inconnu des autos. Je ne croisais leur route qu’en de légères passerelles ou par de petits tunnels percés sous les chaussées.
Au soir de ce cinquième jour de marche, alors que j’allais bientôt arriver et que je croyais déjà reconnaître les formes du paysage, se dressa devant moi la muraille d’une forêt.
J’avais voulu partir sans téléphone, désirant être le plus seul et le plus libre possible, un peu comme un oiseau, avais-je pensé, et je n’avais pour me guider qu’une carte routière un peu ancienne. Je m’aperçus qu’à l’endroit où je pensais être arrivé, elle n’indiquait nulle part de forêt : Aucune de ces taches vert pâle qui indiquent les forêts sur les cartes n’y apparaissait. Pourtant je pensais avoir suivi le bon chemin, et j’avais reconnu l’un après l’autre les hameaux que j’avais traversés, et même la forme assez reconnaissable de mon itinéraire, avec ses lignes droites, ses virages, ses zigzags surlignés de vert promettant d’intéressants paysages C’était peut-être un petit bois qu’on avait négligé de signaler et auquel la nuit trompeuse qui tombait donnait l’apparence d’une forêt. Le chemin disparut sous la voûte des arbres, se réduisant à un passage creusé d’ornières où s’amassaient les feuilles mortes. C’était la première forêt où j’entrais de nuit, et je m’abandonnai au plaisir de la sentir refermer sur moi sa fourrure obscure au parfum de fougère. Cette forêt inattendue serait un plaisir.
J’avais passé tant de temps à peindre des forêts imaginaires, « forêts de l’âme » disais-je, conscient du ridicule et de l’inexactitude de l’expression, qu’il fallait bien qu’elle apparaisse enfin dans sa majesté, la Forêt tout à coup surgie de nulle part, et peut-être encore de mes rêveries. Il me fallait enfin assumer ces divagations que j’avais laissé venir en moi, dans les pages de mes cahiers et au fil des innombrables forêts de papier que je peignais les unes après les autres, presque toutes pareilles, Infinies et ténébreuses, dans lesquelles je me perdais avec avidité, sans jamais rien y trouver. Allais-je enfin comprendre quelque chose ?
Je marchai encore une demi-heure lorsque je discernai loin devant moi, à travers les arbres et filtrée par l’humidité du sous-bois, une lueur pâle, comme suspendue dans l’air. Je pensais avoir atteint la lisière de ce qui n’avait été, finalement, qu’un bois un peu touffu, après lequel la clarté du ciel nocturne se faisait à nouveau. Mais des petits points lumineux percèrent le halo blanc, dessinant une fine ligne horizontale, qui scintillait à travers les arbres.
Je ne compris qu’au dernier moment, au bord de l’eau: un lac s’étendait là, énigmatique et silencieux. Aucun souffle de vent n’en perturbait la surface, aucune ondulation n’agitait les roseaux qui l’entouraient. Une barque semblait dormir, près du rivage. Dépliant à nouveau ma carte, je ne fus pas surpris de n’y trouver ni lac ni étang. C’était peut-être une de ces retenues d’eau qu’on avait creusées ces derniers temps pour prévenir les crues ou, au contraire, faire des réserves en cas de sécheresse, noyant les vallées au fond desquelles le cadavre de l’ancien pays, villages, fermes, bois, champs et chemins, blanchit lentement sous la vase.
Il me revint en mémoire cette pièce pour piano de Debussy qui me faisait rêver : « La Cathédrale engloutie », avec ses angélus glauques émergeant à la surface de la musique.
Une chaîne rouillée, simplement passée négligemment autour du tronc d’un saule, retenait la barque. Je la poussai doucement du pied. Comme si je l’avais réveillée elle gémit en se dégageant des roseaux qui l’enserraient puis glissa, légère, sur l’eau. Si mobile et si libre, elle semblait m’inviter au voyage. Je m’étais, depuis mon entrée dans la forêt, mis avec gourmandise et presque par jeu, dans un état d’esprit qui me disposait ardemment à considérer les choses à travers leur aspect symbolique et presque romanesque, et je me dis que le message que semblait m’adresser cette barque de nuit était bien de me vouer à son apparition. Je m’installai tranquillement et elle m’emporta doucement, ondulant sur l’eau
Quittant la rive pour cette ondoyante surface, j’eus la sensation, presque physiquement, de quitter la réalité pour le monde mobile des rêveries. Naviguer ainsi de nuit au milieu d’un lac imprévu, dans une barque volée et vers une destination inconnue, voilà qui avait plutôt l’air d’un rêve. N’étais-je pas plutôt dans mon lit, au plus profond d’un rêve d’errance comme j’en faisais parfois? Mais si les circonstances me ramenaient aussi près de rêves que j’avais faits, c’était sans doute parce que j’étais probablement parti autant pour rêver que pour retrouver des souvenirs perdus. Je naviguais sur une eau qui m’avait plutôt l’air d’un rêve. Je me souvins tout à coup d’une autre barque, sur un autre lac, où j’avais aussi beaucoup ramé, un été lointain. Un souvenir auquel mon aventure de cette nuit paraissait répondre comme un écho, aussi fidèle que celui que renvoie une falaise rocheuse devant laquelle on crie son nom, au fond d’une gorge envahie de végétations exotiques.
C’était sur un lac d’Italie, dans le nord du pays, au pied des Alpes.
On y avait séjourné en famille, avec ma femme et notre petit garçon, et des amis nous y avaient rejoints, dans une grande maison blanche à l’architecture moderne. Ce lac m’avait semblé lui aussi une énigme. Pourquoi ce mot me venait-il à l’esprit alors que je l’observais, depuis l’une des terrasses de la maison ? Pourquoi, au fait, essayais-je de le « comprendre » ? Peut-être parce qu’il était silencieux, comme un visage fermé. Pâle et sans vie apparente, il était interdit à la baignade. On disait à demi-mots dans les villages riverains que l’eau avait été empoisonnée par des « activités industrielles », quelques années plus tôt. Maintenant il offrait pourtant l’aspect d’un beau paysage, presque sauvage.
Un sortilège semblait l’avoir frappé, et si on pouvait y naviguer, il ne fallait pas en toucher l’eau. Ce lac n’était presque qu’une image. Ses rives s’effilochaient en bandes de roseaux et de bambous. La maison disposait d’un ponton de bois qui partait du jardin et s’avançait au milieu de la végétation, sur des pilotis, jusqu’au-dessus de l’eau. Une barque y était amarrée. On avait fait de nombreuses balades sur cette eau inerte, écrasée par une chaleur lourde et sous un ciel plus blanc que bleu.
Ses rives n’avaient pas le charme de celles des lacs voisins. Pas de hautes montagnes bleues, pas de forêts mystérieuses, pas de châteaux aux tourelles pointues émergeant des pins. Elles s’élevaient juste un peu tout autour, occupées par des champs, des bois et deux ou trois villages aux maisons dispersées. Une ville se tenait au fond d’une baie, qu’on n’apercevait pas de la maison. Très loin vers le nord se dressait le Mont Rose, corail suspendu dans les brumes matinales qui recouvraient toujours le lac à notre réveil. Souvent, en fin d’après-midi, de violents orages venus des Alpes déferlaient sur nous, transformant pendant une heure ces eaux tranquilles en océan sous la tempête. Le palmier secoué sous l’averse évoquait l’Asie et ses typhons. Puis le calme revenait, le lac retrouvait son visage habituel, placide et muet. Des rameurs apparaissaient, traversant le miroir encore gris pâle : Cinq ou six silhouettes, si fines sur une barque si légère, aux rames si longues, qu’on croyait voir un de ces insectes aquatiques qui glissent sans bruit à la surface des étangs.
C’est ainsi que naviguant sur des eaux noires, je revoyais des souvenirs pleins de lumière.
Une masse noire, comme une île basse, apparut assez loin devant moi. Pouvait-il vraiment y avoir une île, au milieu de ce lac, lui-même au milieu d’une forêt ? Peut-être s’agissait-il seulement de roseaux, de broussailles entremêlées ou de rochers émergés. Je décidai de l’aborder.
Il y avait une île aussi, au milieu de notre lac d’Italie, que nous avions bien aimée, un îlot plutôt.
Il était entouré de nénuphars aux grosses fleurs jaunes, où volaient les libellules. Ses contours étaient assez compliqués, formant des petites baies, des fjords encombrés de roseaux.
On l’avait approché timidement, puis on en avait fait le tour, petit à petit, en promenades chaque fois plus aventureuses, comme des navigateurs découvrant une terre inconnue. Enfin un jour, on avait débarqué.
On y avait trouvé une guinguette abandonnée, aux fenêtres crevées et aux murs de planches décloués. Des pins et des petits chênes verts tordus recouvraient presque tout. Quelques débris oubliés, bouteilles vides, papiers d’emballages, révélaient qu’on venait encore là pour des pique-niques, peut-être, sous les ombrages. Plus tard on avait compris que les gens du rivage y venaient le dimanche, dès le matin, pour passer la journée, apportant des provisions, en plusieurs barques. Ils faisaient de la musique, et de loin on entendait rire, crier, chanter jusqu’au soir. Nous n’allions pas sur l’île ces jours-là, respectant ces rendez-vous du dimanche. C’était vraiment un joli coin, une île des plaisirs, comme celle pour laquelle s’embarquent peut-être les hommes en pourpoint grenat et les femmes en soie rose d’Antoine Watteau.
Les enfants adoraient cet îlot, qui les inquiétait aussi un peu. Cette guinguette abandonnée, ces fêtes mystérieuses et ces petits fjords ombragés et encombrés de nénuphars qui semblaient vouloir nous retenir quand nous partions, pouvaient en effet paraître un peu étranges.
Ramant vers cette île-forêt et son immobile reflet, j’eus conscience tout à coup que l’image que je devais donner, dans ce décor, reproduisait exactement ces peintures que j’avais réalisées quelques années plus tôt, en une assez longue série, images d’un rêve que j’avais fait plusieurs fois à cette époque. Elles représentaient un voyageur s’éloignant en barque vers une île couverte d’arbres et qui, tout comme le paysage que j’avais devant les yeux ce soir, se reflétait parfaitement dans l’eau, constituant un objet qui semblait flotter dans le temps et l’espace. « Image onirique », m’avait dit un poète chilien, étrange personnage qui laissait imaginer une réincarnation de Fernando Pessoa. On le rencontrait de temps en temps dans les rue de la ville, en veste de velours noir sur une chemise jaune safran, ou tango, mais sobre tout de même, et sous un petit chapeau dont il prenait grand soin, tenant un léger cartable. Venu à l’exposition où je montrais ces images et, comme le poète de Lisbonne, apparemment sous le poids d’une nostalgie envahissante, il m’avait dit que pour lui ce rameur se dirigeait vers sa mémoire, vers ses ancêtres et vers son origine, « fœtus naviguant sur le liquide amniotique de l’oubli, au risque de se noyer », et il avait baptisé cette série de ce titre : Dégringolade vers les z’hauteurs - ou z’auteurs ? - avec cette jolie prononciation qui m’avait plu. Pourquoi pas ? L’interprétation m’avait paru possible. Il y avait bien dans cette image quelque chose d’un retour, ou d’un regard tourné vers la mémoire.
J’approchais des premières broussailles.
C’était les mille extrémités tordues des arbres noyés, émergeant des eaux. Elles semblaient protéger les abords de l’îlot mystérieux, et, comme autour du château de la Belle au Bois dormant, « en une si grande quantité de grands arbres et de petits de ronces et d’épines entrelacées les unes dans les autres que ni bête ni homme n’y aurait pu passer », ainsi que le disait le récit merveilleux. Prise dans leurs griffes, ma barque s’arrêta. Difficilement, je parvins, en m’agrippant aux branches les plus solides et presque en marchant dans les arbres qui s’affaissaient et craquaient sous mon poids, à mettre pied à terre.
C’était sans doute le sommet d’une colline, épargné par la montée des eaux, couvert d’une masse confuse de rochers et d’arbres de toutes sortes. Il s’arrondissait devant moi comme un grand Tumulus funéraire. De quel vieux roi était-ce là le tombeau? Un sentier s’ouvrait dans les broussailles, marqué simplement, peut-être, par le passage d’animaux sauvages allant boire, chèvres ou sangliers, ou par celui des promeneurs. Venait-on là aussi passer les dimanches ? Je parvins vite au sommet. Vu d’ici, le lac formait tout autour un large anneau d’argent, posé dans la fourrure sombre de la forêt.
Le sentier redescendait de l’autre côté, tout aussi broussailleux.
Et puis plus bas, au milieu des chênes squelettiques, apparurent les restes d’un village à demi-noyé.
Des murs gris pâle se dressaient encore , mais ils avaient l’air près de s’effondrer, cernés par les ronces, hargneusement attaqués par une végétation désordonnée. Des saules, des peupliers, des chênes jeunes avaient colonisé les jardins mais aussi les maisons éventrées, abandonnés à la sauvagerie. Elle régnait en maître sur le pauvre village dépecé. Le clocher désolé surplombait tout ce silence.
Etait-ce mon village ?
Le long d’un mur, je remarquai un vieux banc où retombaient en cascade les fleurs d’un jasmin. Fatigué, je m’y allongeai. Il faisait doux sous les étoiles parfumées ♦
LE JOUR JAUNE

Dans l’après-midi, le soleil commença à prendre l’aspect d’un disque de cuivre, cerné d’un halo rouge sang. Puis le ciel devint jaune.
Sous l’ocre nuée, les visages évoquaient l’Inde, et il fut facile, et enivrant, de se croire à Madras ou à Bombay. Les ombres s’assombrissaient encore et tournaient au verdâtre. Dans cette lumière chaude et jaune, le vert des feux aux carrefours, les phares des voitures -les voitures allumèrent leurs phares- paraissaient d’une acidité surprenante et toutes les couleurs semblaient détraquées.
Dans la rue, dans les magasins, tout le monde parlait du ciel, les yeux levés vers cette lumière inhabituelle. A la boulangerie une caissière parlait de tsunami, mot magique et exotique qui semblait convoquer et résumer toutes les angoisses, quoi que sans aucun rapport avec la situation. Les enfants, sortant des écoles car il était cinq heures criaient tout heureux « c’est la fin du monde ! ».
Je restais à traîner en ville, curieux de la voir sous un autre jour et d’y découvrir des sonorités, ou des saveurs inespérées. La Loire était un Fleuve Jaune, bordé du vert très adouci des saules flexueux, mélancolique paysage dans l' éclairage qui vacillait. Le soleil disparut sous l’épaisse nuée. Alors, Quai de l’Aiguillon, vraiment, je me crus ailleurs.
On apprit plus tard que Le cyclone Ophélia, remontant bizarrement vers l’Irlande, était passé à deux cents kilomètres au large, sur l’océan Atlantique, entraînant les sables du Sahara. Il avait, soufflant un air brûlant, allumé des incendies gigantesques et meurtriers, en l’Espagne et au Portugal. Jusqu’ici, dans l’ouest de la France, on sentit l’odeur inquiétante du feu. Elle se mêla intimement à l’émotion que ce ciel jaune avait suscitée en nous ♦
L' ECOLE DU CENTRE

Le bas relief de Joël Martel, une des plus jolies choses de Luçon, où garçons et filles se donnent la main en une ronde autour du monde, séparait pourtant le portail des filles et le portail des garçons, l'école des filles et l'école des garçons. Nous y attendions notre mère après la classe. Je caressais de la main les courbes tendues comme une étoffe légère gonflée par le vent. Des danseurs, des danseuses, un musicien, des faucheurs de blé harmonisaient leurs gestes dans une heureuse chorégraphie.
Tout semblait promis au bonheur pour toujours. Donc l’humanité serait belle, nos jours ensoleillés, nos cœurs emplis d’amour et de fraternité.
Le soleil de la fin d’après-midi mettait en valeur le beau grain de la pierre blonde. Confusément je sentais qu’on mettait en nous l’espérance que nous serions cette humanité. Confusément je m’inquiétais. Je ne me croyais pas à la hauteur de cette espérance, et j’étais si nul en calcul ! Ça ne faisait rien, j’aimais cette danse, cette brise et ce soleil qui animaient la pierre; ça chantait partout, la beauté existait, quelque chose de plus tangible, ces hommes et ces femmes, ces champs, ces beaux oiseaux et de plus accessible peut-être ♦
LES YEUX

L' ÂME

Ce ne fut sans doute qu’un rêve puissant, provoqué par mon agitation nerveuse. Il me sembla, une nuit, alors que je dormais et qu’elle reposait dans une chambre tout près de la mienne, que ma grand-mère morte deux jours plus tôt dans son lit, traversait ma chambre lentement, très lentement, glissant plutôt que marchant et drapée d’une grande robe d’un gris éblouissant, le gris de la lune qu’on appelle cendrée.
Sans que je pusse bouger un doigt, sans que je pusse fermer les yeux, je la vis et je la sentis me frôler imperceptiblement et disparaître derrière moi par la fenêtre ouverte. Rêve ou réalité, je pensai que son âme douce venait de s’en aller ♦
LA FLÛTISTE

Henri Rousseau: la Charmeuse de serpent
Elle aime parcourir les environs du lac, sur son vélo des années soixante. Souvent elle emporte son instrument et joue en plein air, pour elle seule. Le chant de la flûte à bec, soyeux et boisé, peut emplir les plus vastes paysages. Parfois, il lui semble que les oiseaux lui répondent, une alouette, des corbeaux dans un contrepoint auquel elle s’efforce de répondre, à son tour à leur écoute. Il lui plaît de se rappeler tout en jouant que sa flûte n’est qu’une branche d’érable ingénieusement travaillée, et son souffle qu’un peu du vent qui traverse les montagnes. La musique, se dit-elle, se snobant elle-même, jaillit de ces humbles contingences comme une abstraction pure, une cosa mentale.
Un jour, elle découvrit un kiosque abandonné au milieu des herbes. Il lui sembla que cette scène vide l’attendait, ainsi que tout le paysage déployé alentour. L’après midi était brûlante; se sachant seule, la fantaisie lui prit de jouer nue. Lui revint en mémoire la magnifique Charmeuse de Serpents du Douanier Rousseau, qu’elle admirait, encore enfant, en écoutant des heures durant le Prélude à l’Après-midi d’un Faune, de Claude Debussy. Une reproduction de cette peinture illustrait la pochette du disque. Ainsi avait-elle fait la découverte des deux œuvres en même temps. Il lui avait semblé qu’elles lui révélaient l’existence d’un monde un peu secret et merveilleux dans lequel il lui serait peut-être donné, un jour, d’entrer. Ces deux œuvres sont pour elle indissolublement liées, et précieuses. Le Prélude, peut-être parce qu’elle est musicienne, lui paraît la plus précieuse des deux. Il est pour elle un véritable talisman. Elle pense que cette fascinante mélodie a le pouvoir d’ouvrir la porte de certains paradis.
Elle se déshabilla et s’assit sur les marches du petit bâtiment. Les premières notes du Prélude s’élevèrent au milieu de l’immense paysage.
Ayant parfaitement fait jouer les correspondances (son corps, nu, et celui de la Charmeuse, le panorama sauvage qui l’entoure et la forêt du Douanier, la présente après-midi et celle rêvée par le musicien inspiré), il lui sembla, en jouant, que s’incarnait dans sa musique, portée à cet ultime degré de pureté par l’offrande extrême qu’elle lui faisait d’elle, le chant même du « pâtre divin ».
Plus tard, redescendant vers les hommes par les chemins vicinaux où bruissaient les sauterelles, heureuse et se moquant tendrement d’elle-même, les cheveux flottant dans le vent chaud, elle souriait car elle se rappelait cette charmante exclamation, lue elle ne savait plus où : « Qu’il est de plaisirs pour les âmes sensibles ! » ♦
HULOTTE AU CLAIR DE LUNE, rêve

Je viens d’être réveillé par une petite chouette. Je me lève pour la voir car j’ai l’impression qu’elle est tout près, les moindres inflexions de ses cris étant tout à fait perceptibles, comme lorsqu’on est près d’un musicien. Par la fenêtre de la chambre, j’aperçois un coin de la terrasse dans une ambiance très bleue et très noire d’une belle nuit. Alors que le cri se fait entendre à nouveau, ayant repéré exactement d’où il provenait, je découvre avec ravissement une petite chouette, noire comme une ombre chinoise sur la clarté de la nuit, posée sur une branche de l’un de ces petits arbres qu’on a sur la terrasse.
Je la vois, alors qu’elle chante à nouveau ; je suis si près que je vois les plumes de sa tête, aigrettes légères, s’agiter alors qu’elle finit son hou-hou délicieux. Je l’observe ainsi un long moment, puis je me réveille.
Je me dis alors, réfléchissant à ce doux rêve, que c’est peut-être le vrai chant d’une vraie hulotte qui m’a procuré ce rêve, comme cela arrive souvent, puisqu’il arrive aussi, de temps en temps, qu’une chouette se fasse entendre par ici, la nuit.
Ce que je trouve amusant, quand même, c’est la ressemblance, comme une chose ressemble à son reflet dans un miroir, entre mon rôle dans mon rêve et mon rôle dans la réalité, au même moment. Peut-être que le cri d’une chouette sur la terrasse vient de me faire rêver au cri d’une chouette sur la terrasse ♦
NOSTALGIQUE L' AUTOMNE

LA MORT DU SOLEIL, rêve

Au collège où ma femme travaille, à la fin du cours (mais que fais-je ici ?) une élève, repoussant le rideau sombre tiré sur une après-midi trop ensoleillée, fait timidement la remarque que le soleil est vraiment très gros. Tout le monde rit d’elle mais, tournant les yeux vers le ciel, je m’aperçois aussi qu’il est bizarre. Il me paraît aussi gros que la lune, et montre, comme la lune, des taches cuivrées, dessinant des mers, des continents si visiblement que c’est à se demander si ce n’est pas la lune ou bien le reflet, inexplicablement projeté dans les airs, de la terre elle-même, dans d’autres couleurs. Mais cette lune, ou cette terre, ce n’est pas la lune ni la Terre, car la lumière provient d’elle, on le voit bien, et c’est bien le soleil. Mais alors là, elle a raison cette fille, c’est vraiment bizarre. Personne n’a le temps de s’interroger plus que ça, car tout va très vite. L’astre enfle à vue d’œil, les taches semblent s’agrandir, s’écarter les unes des autres, comme sous l’effet d’une monstrueuse pression interne. Entre elles un extraordinaire rayonnement lumineux jaillit soudain, comme de l’or liquide et le soleil, énorme, explose ♦
DANS LA SOIREE QUI SUIVIT LA MORT DU SOLEIL, rêve

J’ai toujours en tête le fait qu’il y a eu un problème avec le soleil, dans la journée. Je suis maintenant dans un parking, installé dans un champ, comme on en trouve à la campagne quand il y a une grande fête, un vide-greniers géant, et qu'on transforme les champs des environs en parkings herbeux et cahoteux.
Il fait nuit, « évidemment », me dis-je. Je me sens angoissé et déprimé, sans doute à cause de ce qui s’est passé dans la journée. Beaucoup de voitures sont donc alignées dans l’herbe déjà imprégnée de rosée nocturne. Je regarde le ciel et il n’est pas noir uniformément. On y trouve quantité de taches brunes, ocre, comme s’il y avait d’immenses feuilles mortes en suspension, très haut, et mollement bercées, comme celles qu’on voit flotter à demi-décomposées entre deux eaux au bord des étangs l’hiver. Je me dis que ce sont peut-être, sûrement même, les fragments laissés par l’explosion du soleil, dont je me souviens avec une sorte de nausée. Je me dis qu’ils vont rester là pour toujours, dans ce ciel noir pour toujours, faiblement éclairés, détritus flottants, planants, écœurants. J’ouvre la porte arrière d’une voiture, qui n’est pas la mienne, et j’urine dedans, puis la referme, un peu satisfait. Puis je m’éloigne en marchant vers des musiques et des lumières lointaines, là-bas, sous les arbres ♦
(Bizarrement, ces deux rêves, séparés par mon réveil après le premier se suivirent comme deux épisodes d’une même histoire ; j’ai eu la chance de me souvenir des deux, et que le deuxième n’efface pas le premier.)
LE CHÊNE DE VIVELLE

photo Catherine Michau-Guionnet
En forêt de Vivelle se dresse un vieux chêne aux branches dramatiques. Il me rappelle beaucoup ceux qui se tordent de froid dans les ténébreux tableaux de Caspar David Friedrich. Celui-ci se tord peut-être de douleur, car depuis un certain temps, les gens des environs se piquent d'enfoncer, sur tout le tronc et jusqu’à une hauteur que peut sans doute leur permettre d’atteindre une petite échelle, je pense jusqu'à trois mètres ou quatre au plus, des clous de toutes les sortes et de toutes les tailles, clous dorés de tapissier, pointes, vis, pitons, punaises de bureau de toutes les couleurs. On y trouve aussi des médailles, de petites effigies religieuses, des ex-votos devenus mystérieux, souvent improvisés comme, ainsi que je l'ai remarqué un peu surpris, le logo d’une marque de voiture. J'ai pensé que c'était pour remercier qu'un accident d'auto, survenu sur une petite route des environs n'ait tué personne.
Dans une niche vitrée, elle-même clouée sur le tronc, plus haut, une statuette de la Vierge Marie décolorée règne sur cet autel forestier. Des petites chaînes dorées sont suspendues par endroit en festons d’un clou à l’autre, parfois des colliers légers de perles de verre. La mousse, les lichens chevelus envahissent plus ou moins ces offrandes, selon leur ancienneté. Rouille vieille et doré récent de pacotille se mélangent ainsi, tout autour de l’écorce torturée par l’âge et par ces pratiques. Des toiles d’araignées pendent aussi, comme ces mystiques offrandes, devant des anfractuosités dont on se demande si elles sont l’œuvre du temps ou celle de vieux oiseaux morts depuis des lustres au fond de ces cavernes de bois. En s'y penchant, on n'aperçoit heureusement que le reflet glauque d’une perle de verre ou de plastique.
Curieux mélange de pacotille et de mysticisme, de superstition et de foi naïve et pure, ce monument vivant (ses branches douloureuses portaient pourtant allégrement en ce début de printemps des bouquets de tendre feuillage bouclé où chantait un merle), seul au cœur de la légère forêt, semble bien le symbole, ou la preuve, plutôt, de l’espoir toujours vivace, si peu raisonnable mais éternel et si essentiel qui anime le cœur humain.
Ces clous se comptent par dizaines, peut-être par centaines. Parfois ils forment des colonies, des constellations aux ramifications sans fin, que semble leur dicter le relief de l’écorce; parfois ils s’espacent, ou disparaissent comme dans des trous du temps, avalés par la croissance du bois ou de la mousse.
Tout autour de l’arbre, quatre bancs, presque démolis, peut-être cardinalement disposés, et qui semblent faits des branches tombées alentour, accueillent ceux qui veulent prier, ou simplement se reposer, comme nous l'avons fait, ce soir là. Rarement sans doute, car l’endroit est peu connu et les habitants des environs n’en parlent pas facilement. Ces réceptacles de la croyance ont besoin de secret, tout au moins d’une certaine confidentialité, et sûrement d’intimité, la même qui entoure les ex-votos dans l’ombre des vieilles chapelles.
Au milieu de la forêt, ce chêne est entouré d’autres chênes, aussi tortueux et aussi vieux que lui. Comme lui, aucun n’est véritablement magnifique, ni spécialement gigantesque. Pourtant lui seul est devenu un « arbre sacré ». Aucun signe sur les autres d’un essaimage de clous à la tête dorée, de perles décolorées. Lui seul est l’intercesseur avec les puissances divines.
Tant que nous y sommes restés, nous étant assis sur le banc qui nous parut le plus sûr, un coucou a chanté sans arrêt, derrière le rideau encore clair des feuillages environnants. On aurait pu se dire, si on avait voulu, que c’était quelque chose de surnaturel qui nous parlait ainsi. Je le crus sans le croire; mais je me suis dit que le simple fait de penser qu’on pouvait le croire était déjà un premier pas.
La réalité se double toujours d’une aura de mystère et de temps à autre il est bien doux de se le rappeler ♦
"YVER"

"paysage d'hiver" par Jean Hugo; 1965

UN APRES-MIDI AVEC MARINE, rêve

Un jour où l’on marchait en ville avec Marine Le Pen -Catherine était depuis longtemps très copine avec elle- il fut question d’aller prendre un café quelque part, ou à la maison. En route nous rencontrâmes des déménageurs, portant une grosse bibliothèque. Ils regardaient Marine d’un air réprobateur, mais ça la faisait rire, elle disait qu’elle était habituée. Alors, que nous passions près d’eux ils faillirent faire tomber leur meuble sur moi, l’un des déménageurs étant visiblement trop faible. Ses jambes paraissaient « molles comme du coton », aux dires de ses compagnons. Nous décidâmes avec Marine, d’aller prendre le café à la maison, située sur un large boulevard bordé de platanes. Devant la maison, dans un petit jardin, il y avait des dizaines d’enfants, sous des parapluies, assis dans l’herbe et sur les marches d’un petit escalier qui montait à la porte d’entrée. Je m’étais assis, ainsi que Catherine et Marine, au milieu d’eux et ayant trouvé par terre une bouchée au chocolat, enveloppée dans une papillote de papier alu, je m’ aperçus en la goûtant qu’elle était remplie de délicieux Muscadet. D’un air absolument émerveillé je le dis à Catherine et Marine qui se moquèrent de moi : elles le savaient bien, et d’ailleurs, tout le monde en mangeait déjà !
Ce rêve me sembla incorporer des éléments que j’avais récemment rencontrés.
J’avais mangé la veille, avec beaucoup de plaisir, quelques carrés de chocolat, chose que par oubli sans doute, je n’avais faite depuis longtemps. Pendant plusieurs jours, je venais de dessiner des étiquettes de bouteilles de Muscadet pour Eric, un ami vigneron.
Pendant la semaine Marine Le Pen était apparue à la télévision, et la veille encore, sans doute entre deux chocolats, j’avais « déménagé » (un fauteuil de cinéma). Et puis Catherine est très copine avec une fille, Valérie, et elles se promènent souvent ensemble, ainsi qu’avec une autre amie, proche du monde politique. Les enfants, d’où venaient-ils, sous leurs grands parapluies ? Peut-être de cette multitude d’enfants qu’on avait entendu crier pendant plusieurs jours, participant à « Bouge ton été » une initiation à toutes sortes de sports qui se déroulait sur les pelouses et sous les arbres du stade et du parc de Procé pour les enfants qui restent à Nantes pendant les vacances. Et puis il avait beaucoup plu et j’étais sorti avec un parapluie ; la pluie en été me plaît toujours beaucoup, elle me charme et je me souviens longtemps de ces averses délicieuses.
Tout cela a l’air de se mélanger comme dans un collage d’images, ou comme les perles d’un collier de fantaisie ♦
LE MIROIR

Il faisait si chaud en voiture, qu’en apercevant ce petit lac en contrebas de la route, à travers les arbres, elle n’a eu qu’une envie : s’y baigner ! Un chemin qui y descendait lui a permis de se garer sous des eucalyptus un peu poussiéreux et les jolis fruits tombés à terre ont parfumé sa marche, jusqu’au bord de l’eau. « Lac, c’est un bien grand mot, s’est-elle dit, étang, plutôt, ou presque mare, mais ça ne fait rien, c’est charmant ici, et surtout, personne ! » et tout de suite elle a plongé, et la fraîcheur de l’eau a été un vrai bonheur.
Maintenant, allongée au soleil sur une étroite plage de sable rustique, elle se dit que la terre est un vrai paradis, puisque voyageant dans de fabuleux territoires, on peut à tout moment s’arrêter pour butiner de tels délices, et que…
Se réveillant, car elle s’est endormie au milieu de ces vagues rêveries d’après baignade - la baignade lui donne toujours de doux vertiges, qui prolongent sur le sable où elle s’allonge l’ondulation des eaux et l’entraînent vers le sommeil – elle se lève et s’avance pour un dernier bain, un bain d’adieu au lieu, bain d’adieu aux dieux, dit-elle pour s’amuser, avant de reprendre son chemin. Mais ayant remarqué comme le paysage se reflète parfaitement dans l’eau, elle a envie d’y entrer doucement pour n’en pas troubler l’image. Elle entre dans ce miroir qui l’accueille et la reflète à la fois et où s’inversent les collines qui l’entourent. Bientôt ses pieds quittent le fond tiède et vaseux, qui l’écœurait. Libre à présent, précédée d’une suite de lentes ondulations qui mêlent inexorablement le bleu du ciel, le vert sombre des collines, le blanc éblouissant des énormes nuages, inaccessibles montagnes, elle nage vers les beaux reflets des Monts Métallifères que coiffent de sombres forêts. Alors que le paysage mouvant l’entraîne dans un délicieux étourdissement, dans sa tête résonne, comme si un orchestre s’était installé subrepticement au bord de l’eau, l’ouverture de la Traviata : sans doute parce qu’à Livourne, la semaine dernière, sous un ciel bleu très pâle, en partance pour isola Gorgona, elle l’a entendue alors qu’elle admirait un autre reflet, celui de la vieille ville s’amenuisant sur l’eau plate de la rade et devant lequel tournoyaient des mouettes. Au bout d’une minute, peut-être deux, se rappelle-t-elle maintenant à plaisir, la musique avait été brutalement coupée, « familièrement » lui paraît plus juste, et après un grésillement électrique inesthétique, le commandant du ferry avait d’une voix pleine d’entrain, mais solennelle un peu, souhaité en cet italien qui la faisait toujours frémir de joie, une bonne traversée à ses passagers.
Nageant, le visage sortant à peine de l’eau, elle se dit qu’elle est sur le pont d’un bateau, en traversée de quelque baie, et même qu’elle est ce bateau lui-même. Et elle sent avec plaisir les remous se refermer gracieusement sur son dos, s’apaiser derrière elle, comme se refermèrent les flots sur le passage du petit ferry boat.
Elle avait repris le même bateau au retour, c’était ce matin même, et le même rituel avait présidé au départ de Gorgona Scalo. Sans doute était-ce une pittoresque fantaisie du commandant. Elle l’avait appréciée plus encore, alors que masquant l’île qui disparaissait, claquait gaiment le petit drapeau vert et rouge sur le pont arrière où elle s’était installée.
Mais là, elle éprouve tout à coup le besoin de sortir de ces enfantines rêveries, et prise de frénésie, elle bat des pieds et des mains, bouleversant tout autour d’elle les reflets et les transparences. Tout se mélange, le sombre des collines, le bleu, le blanc, le vert du magnifique paysage, et des nuages de vase montent des remous autour de son corps ondoyant. Son rire éclate, clair comme le chant d’une fontaine, un jaillissant jet d’eau, au milieu de la belle solitude ♦
"SEMBLABLES, JUSQU'AUX LIMITES MILLIMETRIQUES DE L'IDENTITE ABSOLUE"*
*Jacques Audiberti, Le Maître de Milan
Ce matin à la boulangerie, j’ai rencontré deux petites filles de treize ou quatorze ans ce matin, à la boulangerie de mon quartier. Elles se ressemblaient tellement qu’on aurait dit la même petite fille deux fois. Leur teint, l’expression de leurs visages doux et sages étaient les mêmes, et leurs cheveux avaient les mêmes ondulations et les mêmes reflets. Les bras, les mains, les jambes de l’une étaient les bras, les mains, les jambes de l’autre. Habillées de la même façon exactement, elles avaient aussi choisi les mêmes baskets blanches sauf qu’une minuscule étiquette collée au talon différait par la couleur, bleue chez l'une, verte chez l’autre . Voulaient-elles souligner par la dimension infime de ce détail leur extrême gémellité, ou voulaient-elles au contraire, par cet invisible ou presque symbole d’altérité, signifier que malgré toute apparence, elles n’en n’étaient pas moins chacune une personne profondément unique ? Elles voulaient des bonbons. Je n’ai pas su si elles aimaient les mêmes ♦
AU CONCERT D'ORGUE

« le bonheur, se dit-il, n’est peut-être que dans l’instant qui fuit. » Yasunari Kawabata, Le Grondement de la montagne
La musique plus que toute autre expression artistique me semble nous placer devant l’évidence de la fuite du temps, aussi cruellement qu’elle peut nous être douce. Est-ce pour cela qu’elle fait si facilement naître nos larmes ? Une magnifique mélodie ne se révèle, et les émotions, les rêveries qu’elle nous inspire, que pour mourir à jamais.
A l’orgue de chœur émerge le crâne chevelu du « professeur Tsuko », en voyage en Europe, d’après le doux présentateur de l’après-midi. Une très fine jeune fille l’accompagne, tournant les pages des partitions. Peut-être sa fille, me dis-je, en l’espérant : Comme dans les romans de Kawabata, leur relation semble empreinte de la même retenue en même temps que de la même profondeur, et d’une silencieuse complicité. Juste devant moi un aimable couple de touristes; ils assistent à tout le concert, se parlant avec une admiration réciproque, la jeune femme un peu espiègle et parfois pensive, l’homme plus dense, plus absent mais sans doute très drôle : chacune de ses paroles fait rire sa compagne. Je ne les entends pas, je ne vois que leurs lèvres bouger, comme dans un film où la musique occupe tout le son, une très belle « litanie » de Jehan Alain ♦
DOUCE AGONIE, rêve
Je sais qu’on m’attend et qu’il va mourir, et je me hâte. Quand j’arrive il est là, assis par terre, au milieu de ses amis.
Ses cheveux blancs sont très longs et son visage jaune pâle est très émacié. Un sourire doux l’illumine quand il me voit. Je prends sa main, m’asseyant près de lui, et il meurt, et tout le monde est content. Qui est-il, je ne sais pas, mais on se connait depuis longtemps, peut-être mon oncle, peut-être un ami ♦
LE FAISEUR DE HAÏKU

N'IMPORTE QUOI!

Que me veut-elle, assise sur la plage, en cette tiède matinée de septembre, à m’observer alors que, la taille entourée d’une serviette de bain un peu courte, je m’évertue non sans difficultés à me glisser dans mon maillot? Ne lui a-t-on pas appris à ne pas fixer les gens ainsi, à plus forte raison lorsqu’ils se contorsionnent comme je le fais, pour rester décent? Peut-être un peu sotte, me dis-je, car sous son gros chignon mou un peu défait, son air est d'un chien battu, mais doux. Cependant un sourire éclaire son visage, fugacement, alors que ma serviette décidément m'échappe et que j'apparais, fugacement aussi un peu nu. Fantasque, ou nymphomane, prête à l'aventure, l'esprit libre? Mais son parfum m'arrive tout à coup, bien qu'elle se tienne à une dizaine de mètres de moi, porté par la brise inconstante qui court sur le sable. C'est un parfum lourd et puissant, qui rappelle les années soixante-dix, musc ou santal? Non, patchouli! A la fois délicieux et indigeste, excitant et inquiétant, évocateur d'amour et d'intimité, plus que de plage en été, de pénombre plus que de ciel bleu. Alors son attitude tient peut-être davantage à l'état d'esprit qui prévalait dans ces années-là: esprit de tolérance, de liberté, d'amour. Et ceux qui s'abandonnent à ce parfum, j'ai toujours pensé qu'ils s'abandonnaient aussi aux valeurs qu'il me semble transporter dans ses lents méandres.
Enfin, je suis prêt, et sans paraître lui accorder d’attention, je descends vers la mer, sachant, ou plutôt souhaitant son regard sur moi alors que ma silhouette diminue.
Quand je remonte vers ma serviette, je remarque que la jeune fille, allongée maintenant sur le ventre, peut-être endormie, car un livre gît, retourné dans le sable à son côté, ne porte en bas qu’un minuscule maillot, si minuscule que j’ai cru d’abord qu’elle n’en avait pas : ses fesses, parfaitement bronzées, ce qui montre qu’elle doit passer tout son temps ici depuis un bon moment, et ainsi offerte au soleil, paraissent nues. Mais un fin cordon, peut-être bleu marine, ceignant sa taille, les sépare, et disparaît entre elles. En haut pourtant, elle est presque trop vêtue, sur une plage : une sorte de gilet assez court, en lainage écru, lâche de maille et léger, fermé dans le dos par un laçage mou et compliqué, et à travers lequel le bronzage émeut. Ses seins, me dis-je, si elle se tournait, seraient bien émouvants aussi, avec leur pointe ingénue traversant par hasard les mailles distendues… Exhibitionniste, un peu? Ca ne me dérange pas ; j’ai pour cette disposition d’esprit la plus grande indulgence. Un body, ça s’appelle un body, me dis-je, et lassé par ma baignade, heureux sous tout ce bleu, satisfait d’avoir retrouvé ces jolis mots en i, body, patchouli, je m’endors un peu. Pas assez pour ne pas "me féliciter de ma félicité ", de cette indéniable et violente sensation de bonheur qu’on a chaque fois après un bain, plus, beaucoup plus qu’après l’amour : Heureux d’être sur terre, presque nu sous le soleil comme un animal innocent, caressé par du vent léger, désirant tout oublier, même la guerre en Ukraine, même le réchauffement climatique, sauf les cris des mouettes, sauf le roulement doux des vagues, sous l’obscurité apaisante des yeux fermés, sous le bras.
Quand je me réveille la jeune fille a disparu ; si ça se fait, me dis-je, elle s’est à peine aperçue de mon existence, si ça se fait, elle ne s'est pas aperçue de mon existence.
J’ai envie de nager encore: la mer m’attire irrésistiblement, c'est comme ça chaque fois.
Et je redescends encore vers l'eau, qui a monté, et qui se fait plus vive, et plus claire encore et dans laquelle je me laisse tomber comme privé tout à coup de mes forces. Quel délice!
Lorsque je me baigne, toujours, j’ôte mon maillot, le portant en bracelet, autour du poignet. J’aime nager nu, libre comme un poisson, dans « la tenue où la nature m’a fait ». Je m’apparais sous les remous ensoleillés, pâle et ondoyant. Elle en fait sûrement autant, me dis-je, et d’ailleurs ne suis-je pas moi-même une jeune fille un peu sotte? Un peu exhibitionniste? Et je nage et je nage, vers le large. Un peu fantasque? Un peu nymphomane? Ne suis-je pas la seule jeune fille sotte de cette plage, déserte à présent? ♦
DEUX ERRANCES CHOUETTES

Une nuit où je marchais dans les rues désertes de la petite ville où j’étais né et où j’étais venu voir mes parents, une chouette tout à coup cria haut dans le ciel au moment même où elle me survolait. Elle décrivait de belles boucles au-dessus des maisons ensommeillées, dans un itinéraire que je suivis, autant par jeu que par goût du mystère. Je me plus à me dire que l’oiseau de nuit m’incitait à le suivre, s’éloignant puis revenant vers moi, comme ferait un chien entraînant son maître vers un but connu de lui-seul. Où, la suivant, allais-je aboutir, à quel secret, devant quel portail mystérieusement ouvert, alors que les habitants s’étaient abandonnés au sommeil ? Mais elle disparut tout à coup dans le noir du ciel et ses cris se firent lointains, puis se turent. Je me retrouvai seul au milieu des rues vides, dernier oiseau nocturne et solitaire ♦
Au bout de la rue Michel Rambaud, le carrefour était désert. Les voitures semblaient dormir depuis toujours, je marchais sans faire de bruit. Chez Nico, c’était fermé. Un papier collé derrière la vitrine annonçait la fermeture pour fin décembre. De quelle année ? À travers les stores vénitiens, je crus apercevoir dans l'obscurité, des vêtements, toujours suspendus sur les portants. J’étais sûr que, si j’avais pu entrer, j’aurais retrouvé l’odeur de naphtaline qui régnait dans le magasin où ma mère venait choisir ses robes. Plus loin, rue du Port, j’aperçus une chouette effraie sortir d’une lucarne de la grande maison où nous avions habité quelques mois dans les années soixante. Depuis longtemps elle était à vendre. J'imaginai, plongés dans l'obscurité et le silence, la minuscule cuisine, le long couloir étroit qui en part, le grand salon dont les fenêtres vibrent quand passent les voitures et au bout du couloir, l'escalier qui grimpe vers les chambres, décor vide comme un théâtre après la représentation. La rue que je suivis ensuite me rappela le court trajet (cent mètres, tout au plus?) que nous faisions entre la maison et l'école maternelle où ma notre mère nous emmenait, mon frère et moi, chacun de son côté lui donnant la main. Je me souvenais de la voiture de la maîtresse, garée devant l’école quand nous arrivions, une Amie 6 bleue pâle; sa couleur et ses formes me rappelaient la douceur de sa conductrice. Pourtant un matin j’avais remarqué un oiseau, mésange ou moineau, cruellement pris dans la grille de la calandre ♦
UNE APRES-MIDI DANS UNE JACINTHE SAUVAGE
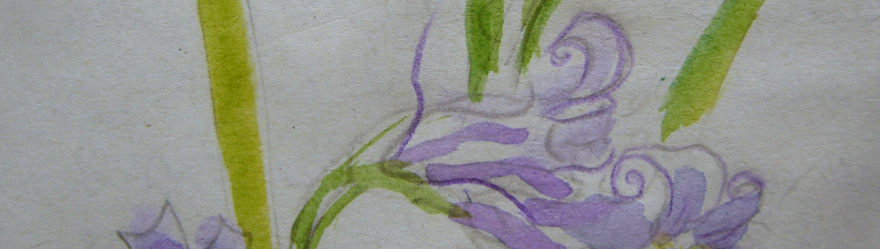
Diable, se disait-il, je donnerais cher pour parcourir les boucles mauves de cette clochette, même un peu fatiguée. Ayant gravi la verte tige où ses pieds et ses mains s’agrippaient comme s’il avait été puceron des bois, il s’imaginait maintenant prenant pied sur le pétale, et baissant la tête pour passer sous les lourdes étamines, il se voyait s’enfoncer sans crainte dans le clair calice.
Là, tout environné de mauve et de suave odeur, il s’allonge, à demi enivré, les pieds au fond du calice, la tête à son ouverture.
Ayant dormi un peu, bercé par un zéphyr de vieux poème, il se réveille pour découvrir tout autour de lui un merveilleux spectacle.
Comme les toits innombrables d’une ville ancienne, des centaines de clochettes, du mauve presque blanc au violet des violettes se pressent tout autour, vibrant dans l’air, avec leurs pavillons parfois dressés vers le ciel, exhibant leurs étamines dorées, parfois inclinées jusqu’à l’horizontale, comme celui où il s’est installé, ouverts comme des cavernes au flanc des montagnes, parfois encore inclinés pieusement vers la terre, comme des cloches d’ église ; ça et là les longues feuilles traversent ainsi que des épées vertes le nuage des fleurs et fusent, flèches victorieuses, fières, heureuses, vers le ciel.
Ville, certes, mais ville de fleurs, ville que nulle main n’a construite, nulle mandibule n’a menuisée, nul bec n’a laborieusement tressée.
Ville mouvante et parfumée, apparue l’espace d’un printemps et qu’ en tout cas, se dit-il, il fait bon pour le moment d’admirer, de ce doux balcon.
Perdu dans ses pensées, ainsi qu’il se décrit gentiment, car voici qu’il s’aperçoit qu’il avait quitté ce pétale pourtant confortable pour le plus inaccessible encore jardin de son enfance, l’un d’eux en fait, car il y en eut plusieurs : celui de son grand-père. Car les mêmes clochettes, pareillement parfumées y fleurissaient discrètement, au printemps, derrière du buis, sous le grand noisetier. Perdu dans mes clochettes, plutôt, se corrige-t-il plaisamment.
Mais un bourdonnement puissant le tire tout à coup de ses souvenirs fleuris. Celui d’une belle abeille noire, bleue de reflets, de celles qu’on nomme charpentières, et qu' il a récemment découverte dans le jardin d’un ami. Alors qu’elle vole en sur place, à deux doigts de son balcon, tout occupée à butiner la clochette voisine, il enjambe hardiment le vide étroit qui le sépare de l'animal, et s’installe sans façon sur son dos. La fourrure est chaude, vivante, et le dos aussi large que celui d’une pouliche normande. Et il se plaît-il à le lui crier à l’oreille. Visiblement flattée, elle l’emporte en zigzaguant dans le soleil, croisant le vol d’une multitude d’autres créatures. Et c'est ainsi qu'ils passent l'après midi, butinant de clochette en clochette, de calice en corolle, de corolle en ombelle charmante par les bois et les champs. Monter à cheval lui a toujours fait envie, mais lui a toujours également fait peur: les chevaux sont bien inquiétants, toujours apeurés, toujours fantasques, et si hauts! C'est vrai, monter une abeille est plus simple, plus doux, et il se demande pourquoi il ne l'avait jamais fait jusque là; c'est simple, se dit-il, personne ne lui a jamais proposé, et peut-être même, personne n'y a jamais pensé! Incroyable! Et pourtant si évident! Et si agréable! Quel bonheur, enfin, pour un humain, que de pouvoir voler où et comme bon lui semble! Et voici donc que les plus belles prairies défilent sous leurs pieds, qu'ils survolent en doux zigzags les plus belles ombelles, qu'ils passent sous leurs plus tendres ombrages, visitent les flèches enivrantes des hautes digitales, où butine un bourdon solitaire. Mais il a peu l’habitude de voler ainsi, et la fatigue au bout d'un temps se fait sentir, et il demande à sa belle monture si elle veut bien le ramener chez lui. Pas de problème, lui répond-elle, je te dépose. En plus, se dit-il, avec elles, on peut parler et, flattant son encolure velue, caressant son abdomen dodu, il la guide jusqu’à sa terrasse, gracieusement suspendue au-dessus d’un beau jardin.
C’est là qu’il se retrouve, le nez -seulement- dans ses clochettes, celles qu’il a cueillies la veille dans un chemin creux du côté de La Paquelais ♦
VERS DE L' INSECTE POETE AU PRINTEMPS CACHOTTIER


LETTRE A UN AMI

Près de Saint Juire-Champgillon, où je suis né.
Oui, cher Gérard, je te parlerais bien de Vendée, mais ce serait une Vendée d'il y a cinquante ans, quand j'en avais dix, sans les bretelles de sortie, sans les centres Leclerc, sans les super U; des routes assez venteuses, souvent, avec des bouses de vache desséchées, doucement parfumées, et où l'on croise des camions de lait dans les virages, et le fourgon du Magasin Vert, familier des chemins, butinant de village en village. Un peu désolés, ces petits et ces gros villages, jolis parfois, sans le vouloir, recélant des manoirs aux volets gris, des châteaux d'avant, aux tourelles de guingois qu'on aperçoit à travers leurs bois broussailleux, villages qui s'ennuient et que traversent des enfants à vélo, à Mareuil ou à Lavaud par un jour d' été trop chaud. Tout cela n'existe plus, tu sais. Mes maîtres d'école sont presque tous "partis", je ne veux savoir où, et quand je viens à Luçon je ne connais personne, "que sont mes amis devenus", je l'ignore.
Il y a encore des îles de l'autrefois qui subsistent, et je navigue de l'une à l'autre, mais il faut fermer les yeux pendant la traversée si l'on ne veut perdre son rêve. Dans les allées du Jardin Dumaine, certains lauriers m'ont connu enfant, et les choucas qui dorment la nuit sur la façade de la Cathédrale, "si ça se fait", sont les mêmes que ceux qu'à l'école, je regardais rêveusement, enviant leur liberté, pendant le cours de géographie. Je reconnais leurs criaillements brefs et qui résonnent, et leur façon de tourner sans fin autour du clocher, grand petit coquillage nacré ♦
ROBERT ET LES FORETS, POEME EN R.V.B.


LA STATUE

Un jour d’été que la canicule avait jeté la population dans les jardins publics et sur les quais, Lucile, en traversant le Jardin des Plantes dans une grande robe de soie écrue, remarqua une stèle vide. Le savant ou le bienfaiteur de l’humanité qui l’avait occupée jusque là, était sans doute parti en séjour à la montagne, pour avoir frais, se dit-elle plaisamment. Préférant cette réponse à une explication rationnelle qui, elle le devinait, aurait probablement envisagé le besoin d’une restauration devenue indispensable en raison du vieillissement du matériau - marbre ou granit, au fait, ou bronze ? - elle ne le savait pas, ou le remplacement d’une gloire locale et oubliée, - ou révoquée pour indignité à la suite de l’évolution des sensibilités - elle s’amusa un instant à échafauder des hypothèses amusantes parce que sans intérêt. Une chose était sûre en tout cas : bien qu’elle passât là tous les jours ou presque, elle n’avait jamais levé la tête vers cette image, cette image en trois d, se plut-elle à conclure.
Mais elle s’arrêta soudain, car une idée lui vint à l’esprit, et faisant demi tour, car ses réflexions l’avaient déjà éloignée, elle revint à la stèle désertée. C’était un beau sous-bassement de pierre finement ouvragé, comme on en faisait au 19ème siècle, cylindrique et large. Elle quitta vivement ses tongs dorées, les cacha derrière le petit monument et lestement grimpa sur le socle, s’aidant des moulures, bords et rebords, sauts et ressauts qui en rythmaient la hauteur et qui offraient à ses pieds menus autant de marches qu’un escabeau.
Ce premier geste n’aurait sans doute choqué personne, s’il avait eu des témoins, ne révélant qu’une fantaisie rieuse, une espièglerie que l’ambiance « grandes vacances » de cette journée de juillet autorisait aux citadins restés en ville. Le second en revanche aurait sans doute suscité plus de reproches, et peut-être même des protestations bruyantes, car Lucile, dès qu’elle se fût assurée de son équilibre sur la haute pierre fraîche, fit tomber sa robe à ses pieds, et en un instant, fut absolument nue. Puis elle s’assit, dans une attitude qu’elle avait remarquée quelques jours plus tôt au Musée des arts : celle d’une sculpture hyperréaliste, à la fois pudique et sensuelle. « Pudique et sensuelle , se dit-elle amusée, mais nue, néanmoins ! Sensuelle sans doute, mais aussi pensante, comme un Rodin, et renfermant en elle la densité d’une méditation, le poids d’une profonde intériorité, celle des Méditerranées et des Nuits d’Aristide Maillol ! »
En effet, Lucile, avait eu immédiatement la fantaisie d’associer l’idée de prendre place sur ce piédestal vacant –rêvant qu’elle le méritait- à celle d’y paraître aussi nue qu’une déesse grecque. C’était un fantasme qui la poursuivait depuis toute petite, et auquel elle se soumettait de temps à autre avec le plus vif plaisir. Elle l’avait baptisé du nom de Complexe de Vénus et en faisait, en riant d’elle–même, sa maladie mentale. D’autres appelaient ça de l’exhibitionnisme, terme nettement moins poétique, trouvait-elle, et elle leur en laissait négligemment l’usage. Elle en avait trouvé de nombreux exemples dans la littérature, dans la peinture et aimait à y réfléchir parfois. Presque tout le monde aime se mettre à nu, se disait-elle, mu par un profond et inaccessible désir d’apparaître aux autres sans masque. Pour elle, le simple fait de se dévêtir, même sans témoin, était un plaisir en soi; elle était son propre témoin, cela suffisait. Il lui semblait ainsi être plus libre, et plus vraie, plus elle-même; fantaisie qu’elle s’autorisait, et qui ne lui avait jamais valu le moindre ennui. Ses amants et amantes avaient reconnu et parfois apprécié ce penchant, car contrairement à un personnage qu’elle avait rencontré dans une nouvelle d’Anaïs Nin, elle n’avait jamais été scandaleuse, n’avait jamais choqué la sensibilité, jamais dérivé dans le vulgaire ou le dérangeant. Elle pratiquait donc son fantasme avec retenue et légèrement, avec un naturel qui désarmait. Enfin, ce n’était pas chez elle une obsession, c’était un désir qui parfois la prenait comme vous prend parfois l’envie d’un croissant fourré à la framboise ou d’une glace à la fraise. On pouvait sonner à sa porte sans qu’à chaque fois elle ouvre en état de nudité.
La hauteur de sa position et l’ombre dans laquelle elle se tenait -la stèle occupait un profond renfoncement dans l’épaisseur de la haie et était dominée par un lourd magnolia– la gardait d’une trop grande proximité avec les promeneurs éventuels. L’ombre verte la nimbait d’une sorte d’irréalité et on n’aurait pu percevoir le rosé nacré et pâle de son teint : une vraie odalisque de Foujita, se disait-elle s’observant. Elle enveloppa sa longue chevelure noire dans sa robe, comme en un lourd turban, en en laissant retomber le drapé ses épaules. Elle se rappela ces statues humaines qu’elle avait vues ces dernières années dans les villes touristiques de la côte, avec leurs postures exagérées, leur face pétrifiée sous une pâte blanche ou même couleur d’acier, et elle se demanda un instant avec angoisse, si elle ne les imitait pas. Quelle horreur: Leur immobilité était parfaite, mais tout à coup, un bras se dépliait lentement, la tête tournait mystérieusement, et toute l’attitude se délayait, glissant jusqu’à une autre attitude où elle se bloquait comme une mécanique stupide. Elle avait toujours trouvé ce genre de spectacle dérangeant, et elle ne savait au juste pourquoi, le jugeait de mauvais goût.
Ce qu’elle avait envie d’imiter, elle, n’était pas l’immobilisme des statues, mais leur nudité même: L ’immobilité n’était qu’une évidente et presque accessoire conséquence de leur état statuaire, mais leur nudité était bien ce qui les motivait, ce qui leur conférait tout leur pouvoir d’ensorcèlement, et elle revoyait encore les Maillol, les Rodin, les Claudel. Elle se plut, alors que se rapprochaient des pas dans les graviers de l’allée, à se dire qu’elle innovait dans la discipline, d’abord par sa nudité totale, qui avait valeur d’engagement, par l’absence de tout dispositif scénique, et par le genre d’immobilité qu’elle se proposait de pratiquer, une immobilité facile , dans une pose confortable, assise, et qu’elle ne romprait par aucune variation spectaculaire et trompeuse - car c’était en réalité pour se défatiguer que ces zozos et zozottes changeaient de posture, se disait-elle, incisive enfin- et qu’elle ne figerait pas non plus au-delà de l’humaine condition, qu’elle ne pouvait nier. Qui l’aurait observée avec un peu d’attention aurait décelé sans peine le mouvement de sa respiration, et peut–être la vibration du vivant. En cinq minutes elle avait déjà élaboré sa démarche et son esthétique! Elle voulait seulement qu’on ne s’aperçoive pas trop facilement qu’elle était vivante, mais non pas qu’on s’étonne que vivante, elle parût de pierre.
Elle aimait philosopher ainsi pour elle-même, alors que sa parole était d’ordinaire plutôt réservée et jamais savante. Ainsi rêvant, elle avait atteint une certaine tranquillité d’esprit et son attitude s’était faite plus naturelle, et c’était son meilleur déguisement. Les paupières baissées presqu’entièrement, on n’aurait pu distinguer l’éclat de son regard aiguisé, mais pourtant elle observait parfaitement tout ce qui se passait à ses pieds, tout ce qui passait à ses pieds : pour l’instant ce n’était que les petites allées et venues des moineaux énervés pas la chaleur, se disputant des graines sans doute, minuscules, des miettes, des riens, imaginait-elle. Sous la frange de ses cils, elle vit d’abord un jeune couple entrer dans son champ de vision : ils marchaient enlacés, ne semblant pas souffrir de la température, collés l’un à l’autre et sans doute en sueur l’un et l’autre. Ils passèrent lentement devant elle, l’ignorant comme une vulgaire mythologie ; elle en fut ravie, mais il était probable qu’ils ne l’avaient pas même aperçue ; ça ne fait rien, se disait-elle, je suis devenue une naïade de jardin public, et je ne saurais éprouver le moindre sentiment. Ayons le cœur de pierre!
Dans ce coin du jardin, assez éloigné de l’entrée, et un peu à l’écart des grandes allées, les visiteurs étaient assez peu nombreux, et comme il n’y avait pas de banc, nul n’y restait longtemps : pas non plus de curiosité à admirer, pas d’arbre remarquable, pas de fleurs inconnues, juste cette statue oubliée. Pourquoi y avait-il donc des statues, d’ailleurs, se demanda-t-elle, si personne ne leur prête attention ? Elles ne remplissent aucune fonction, si ce n’est peut-être d’être de poétiques lieux de rendez-vous ; elles sont là et c’est tout, répondant seulement au besoin de quelques rêveurs de dresser dans les jardins ou au milieu des carrefours une figure magique.
Une femme passa, son smartphone en main, plongée dans une discussion. Il était question de vacances, de départ, de train, de vendredi et de Bretagne. « Ennui, se dit Lucile, ennui et ennui, quel ennui, les vacances et l’été… » La femme s’était arrêtée juste à ses pieds, lui tournant le dos, tenant son téléphone comme une gaufre dont elle aurait sucé le bord. Elle avait envie de caresser du bout du pied les cheveux rose vifs de la femme, mais elle se retint, jugeant que cela la mettrait en danger et que ce geste aurait peut-être quelque chose de méprisant, ce qu’elle ne voulait pas. Cela certes aurait été de sa part une simple moquerie gentille, mais comment expliquer cela, dans son état de statue vivante ? Elle aurait eu du mal, se dit-elle. Deux jardiniers entrèrent alors dans son champ de vision, et la femme s’éloigna, toujours absorbée dans ses projets de voyage, revenant aux horaires des trains et des risques de grève. « Ô ennui » se dit Lucile.
Ayant probablement fini leur journée, les deux hommes en tenue verte traversèrent le petit espace, l’un poussant une brouette remplie de feuilles sèches, l’autre portant deux râteaux aux dents fines et longues. « Chacun le sien, se dit Lucile, c’est mignon… ». Ils n’avaient pas un regard pour ce jardin, pour ces arbres, pour ces allées et ces statues qu’ils connaissaient par cœur, et qui n’étaient que le cadre de leur travail. La tête penchée vers le gravier rose et leurs grosses chaussures de travailleurs, eux aussi parlaient de leur vacances prochaines, de paddle à Saint Jean de Monts.
« Décidément, se dit Lucile, j'ai dû me transformer vraiment en dame de béton ou de calcaire, couverte de pollen ou de lichen gris, pour me punir de ma fantaisie, comme dans les Métamorphoses d’Ovide, et que je ne vais plus jamais pouvoir descendre de mon piédestal ! » Mais bougeant un doigt, une main elle put constater sans surprise que les métamorphoses n’appartenaient plus qu’à une époque révolue.
Donnant la main à un petit garçon d’une dizaine d’années, une femme âgée, en T-shirt blanc et coiffée d’une casquette à visière de plastique vert transparent apparut. Elle échangea, en les croisant, quelques mots amicaux avec les jardiniers, qu'elle devait connaître. Elle leva les yeux vers Lucile, mais l’enfant réclamait un gâteau, ou une glace, et il la tirait par le bras sans s’occuper d’autre chose, ni d’elle ni de la statue devant laquelle elle s’était arrêtée une seconde et qu’elle tentait de lui faire remarquer. Mais il la tirait sans ménagement vers la grande allée, où se tenaient pour l’été un manège ancien et une petite pâtisserie dans un joli camion bleu pâle.
Au-dessus d’elle, une tourte qu’elle n’avait pas remarquée, se mit à roucouler, comme s’éveillant tout à coup. Son chant avait toujours été un plaisir pour Lucile, et il lui sembla qu’elle était plus proche de l’oiseau, en étant statue de jardin, qu’elle ne l’avait été jusque là, humaine créature. Elle eut envie qu’il vienne se poser sur sa tête, qu’il vienne s’endormir sur son épaule, érotique version d’une Léda moderne ! Mais le chant de la tourte n’avait rien de dramatique: il n’évoquait que la douceur de la vie, la tendresse de la saison.
Un jeune homme chargé d’un sac à dos, passant alors, leva les yeux vers l’oiseau, le cherchant du regard dans le feuillage verni du magnolia. Ce devait être un voyageur dans l’attente de son train. La gare était toute proche, et comme de nombreux voyageurs, il avait dû venir chercher dans ce jardin un peu de calme et de fraîcheur entre deux
correspondances. Il était sans doute très jeune, et paraissait un peu perdu dans cette grande ville qu’il ne connaissait pas et où il se risquait avec prudence. Ses yeux se posèrent alors sur Lucile, un peu étonnés. A travers les minces fentes de ses paupières presque fermées, elle suivit le regard du jeune homme parcourir son corps, descendre jusqu’à ses pieds, juste au bord de la stèle. La pierre avait communiqué sa fraîcheur à ses menus orteils, et ils paraissaient, dans l’ombre glauque, taillés dans la même matière, ce qui étonnait la jeune fille. C’était bien d’ailleurs ce qui fascinait Lucile, dans les sculptures inspirées, qu’elles aient le pouvoir d’évoquer à travers le même matériau, aussi bien le cheveu que la peau, le lourd que le léger, le voile tremblant que le puissant métal, la pierre dure que le « sein palpitant », et c’était bien là pour elle un des charmes de cet art. Le jeune homme, qui n’osait bouger, semblait étonné par quelque chose qu’il ne comprenait pas, qu’il ne cernait pas. Et Lucile, interdite, se faisait le plus statuaire qu’elle pouvait. Sous cette observation, elle craignait quand même d’être décelée, et c’était terriblement dangereux, et terriblement excitant.
Le regard du jeune homme la parcourait de la tête aux pieds. Elle sentit comme il s’attardait sans façon sur ses seins, comme il descendait lentement sur ses hanches, rebondissaient sur ses cuisses, glissait jusqu’à ses pieds. Comme elle était placée à deux mètres de haut, et qu’elle était assise, dans une pose « pudique », on ne pouvait apercevoir l’obscur buisson qui l’aurait trahie. Le jeune homme l’admirait, visiblement, et ne semblait nullement honteux d’admirer une femme nue, plus qu’une œuvre d’art, fasciné par tant de beauté inattendue. Et elle, elle exultait, buvant avec délice le plaisir qu'il lui faisait, son fantasme s'exauçait merveilleusement. Il s’éloigna enfin, en murmurant, « elle est magnifique, magnifique… »
La chaleur finissait par avoir raison des promeneurs. Ils s’étaient réfugiés sous les marronniers, les platanes, les ormes, les charmes, les tilleuls odorants, les noyers d’Amérique, ils s’étalaient sur les bancs, les pelouses autorisées, les chaises longues décolorées, cherchant à reprendre leur souffle, abandonnant leurs téléphones, leurs journaux, leurs livres de la bibliothèque municipale aux pages ouvertes. Les oiseaux s’étaient endormis au fond des haies. Dans le ciel de feuillage où Lucile se tenait encore, l’oiseau s’était tu. Elle avait chaud, maintenant, même nue, et elle s’aperçut qu’elle s’ennuyait.
Alors elle se leva, sans crainte qu’on la vît, s’étira, dressée sur sa pierre, bâilla longuement, et le turban de sa robe tomba à terre. Puis elle descendit, souple comme une liane, passa sa robe, qui l’enveloppa en un éclair comme l'eût fait un nuage divin et chaussa ses tongs d’or.
En quittant son petit théâtre de verdure, elle croisa la vieille femme et l’enfant. Ils léchaient chacun une magnifique glace rouge, à la fraise : elle perçut au passage le délicieux effluve. Elle entendit la vieille femme s’exclamer : "ça alors, la statue, elle a disparu…Ah ça, c’est pas ordinaire alors ! Regarde, Gabriel, la statue !... Et l’enfant riait aux éclats : Ah ah ! mamie, elle est partie, elle est partie se promener, s’acheter une glace, elle avait chaud, c’est normal, mamie ! - Tu rigoles, répondait la vieille femme, mais c’est vrai, il y avait une statue, là, y a même pas un quart d’heure, c’est pas ordinaire, ça alors !" répétait-elle en elle faisant le tour de la stèle désertée, scrutant les alentours comme si la statue avait pu s’éloigner dans une allée voisine.
Lucile s’éloigna doucement, amusée, charmée. On entendait encore la vieille femme: « Elle était magnifique, et je m’en souviens, c’est pour ça que je l’ai remarquée, on aurait dit une vraie… » L’enfant riait, et l’entraînait plus loin. «Viens mamie, on va voir les cactus ! » ♦ (avril 2024)
LA MER

GLORIETTE PARADISO

LE CAOUTCHOUC, rêve

Je ne sais pas d’où m'est venue tout à coup cette envie qui me traverse comme une urgence: Demander un autre imperméable en caoutchouc à ce couturier qui m’en avait déjà confectionné un premier il y a quelques années! Vite avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne ferme boutique, avant que les pluies ne tombent plus, avant que je meure!
Et je me précipite à sa boutique, sous les arbres légers d'un large boulevard.
Vibrant de désir, je lui demande s’il fait toujours des impers en caoutchouc; "Mais bien sûr, cher Monsieur, répond-il doucement, avec un agréable sourire. Il a une assez belle allure, courtois, chic, et un petit quelque chose de narquois, ou de moqueur, qui flotte dans les yeux. Plein de reconnaissance pour lui, je lui demande s’il voudrait bien m’en faire un autre, comme il y a quelques années. - "Ouiii, je m’en souviens très bien, c’est tout à fait possible, cher Monsieur, ce sera avec plaisir, pour quand le désirez-vous ?"
Ces imperméables me plaisent beaucoup. Cousus dans des pneus usagés, leur aspect brut et noir mat me plaît et ils sont étrangement souples. Je les aime aussi car personne n’en porte, sauf moi, qui suis sans doute seul à connaître leur existence.
"- C’est combien, déjà ?" demandé-je assez confiant: Je sais que le prix était étrangement insignifiant, et cet aspect des choses m'avait rendu ce vêtement encore plus précieux, comme si j'avais découvert moi-même un trésor insoupçonné, comme si sa valeur n'avait rien à voir avec son prix de vente et en était immensément au-delà. Mais, se reculant légèrement, il me contemple et me mesure des yeux, tourne tout autour de moi, dodelinant de la tête, multipliant en chantonnant les hauteurs, les largeurs et le prix des différents caoutchoucs à utiliser. Enfin, et alors que je m'étonne, puisqu'il semble se reprendre dans son estimation, remultiplier et re additionner les résultats, que le prix ait autant à voir avec des métrages et des prix de matières, il m'annonce gaiment ce chiffre, toujours avec ce gracieux sourire aux lèvres:"- Autour des trois mille euros, cher Monsieur, même peut-être un peu moins, chiffre qui d'un coup me coupe le souffle, et l'envie. - Ouh là, dis-je, comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre, ça a augmenté, la dernière fois vous m’avez demandé vingt cinq euros, je crois, je ne comprends pas, c’est beaucoup beaucoup plus cher, là ! - Ah oui je sais, je suis désolé cher Monsieur, mais vous savez, le prix du caoutchouc a flambé, ces derniers temps, c’est dingue, c'est dingue ! et il lance ses belles mains en l'air, vers le lustre de cristal, qui semble représenter toute la richesse à laquelle l'incroyable caoutchouc est parvenu. Oui mais c’est du caoutchouc de récupération, quand-même. – Ah ah! Même de récupération ! et j'allais dire: surtout de récupération! on est sur du Good Year, là, du Pirelli, grande marque italienne, grande grande marque, c'est eux qui fournissent Ferrari, Lamborghini, Monteverdi!" Je me demande s'il ne se moque pas de moi, maintenant; quel escroc, quand même, me dis-je, rien qu'à son air j'aurais dû le savoir! Il a compris que j'adorais son imper et il en profite, alors qu'il devrait me remercier de lui en avoir fait réaliser la valeur! " - Et on n’en trouve plus, en plus, maintenant c'est du vinyl, de l'acrylique, les nouveaux pneus chinois !", ajoute-t-il, l'air désolé et juste un peu méprisant, juste assez pour que je le ressente.
Très déçu, je m’apprête à quitter la boutique, tirant la lourde porte vitrée, ornée en son milieu d'une belle poignée de fer forgé. A ce moment il pose la main sur mon bras, palpant légèrement et presque affectueusement ma manche en disant :"- Ah! C’est un beau cuir, que vous avez là… » Je regarde mon bras: effectivement, je porte une belle grosse veste de cuir, presque blond.
Oui, elle me vient de mon père", dis-je…
Cette veste existait bien, et je l’ai portée quelques fois vers l’âge de vingt ans. Le cuir était presque roux, pas blond comme dans mon rêve. Lourde et confortable, je m’y sentais protégé comme dans une armure souple. Ce sentiment venait sans doute aussi du fait qu’elle était à mon père qui l’avait portée il y avait bien longtemps. Il ne l’utilisait plus. Un jour je l’ai perdue quelque part, je ne sais où. Je l’avais oubliée. Pas complètement, finalement; puisque je l'ai retrouvée dans ce rêve. Les choses n'ont pas disparu, quand on rêve encore d'elles: Leur existence change juste de nature, elle n'en est pas moins réelle ♦
MER BELLE A TRES BELLE

C’est ce chant bizarre, qui m’a tiré du lit. J’ai cru d’abord à un oiseau nocturne, rare; mais quel oiseau étrange ce devait être, avec ce chant flûté, sur une seule note un peu triste, répétée, comme si la nuit elle-même chantait, ou mesurait sa durée, mélancolique et obstinée, bip, bip, bip, ou plutôt, bûu... bûu... bûu…! Oh, si joli! J’ai enfilé mes tongs qui semblaient m’attendre devant la porte, et j’ai traversé le petit jardin, pour surprendre l’oiseau. Son chant m’a guidé; il était juste au bout de l’allée, au milieu, bûu... bûu… bûu... un crapaud. Immobile et solitaire, qui appelait-il ainsi ? Pourquoi tu chantes comme ça, toi, lui ai-je demandé. La sérénité de l’heure, la douceur de l’air, le parfum de la mer et des fleurs qui dormaient, tout cela devait l’avoir ému, et il avait joint son chant à celui de la nuit. Son chant m’avait fait imaginer un oiseau frêle et léger, et je ne pouvais m’empêcher de trouver à ce discret et modeste crapaud quelque chose d’extrêmement touchant, comme si j’avais entendu d'une personne désavantagée par la nature les paroles les plus délicates. et comme son chant, poétique et spirituel, contrastait avec son allure! J' étais tout disposé à lui rendre grâce, à l'approcher au plus près afin de découvrir sa beauté cachée, me reprochant de l’avoir jusqu’à cet instant présent méconnu, et je m'agenouillais juste devant lui, mais, apeuré sans doute par mon immense silhouette pleine d'ombre, il se tut, et bondit sans un bruit, élastique, quelques centimètres plus loin; de bond en bond, il se glissa sous le petit portail de bois et disparut dans le bord du chemin, sous les buis et les giroflées.
J’ai ouvert, et j’ai remarqué au ciel, que ne masquaient plus les feuillages noirs de l'acacia, le grand nuage stellaire, dessinant un chemin, vers la plage. Elle n’est pas loin, et j’eus envie de voir la mer sous les étoiles, si elle luisait, si elle absorbait leur reflet, s’il y avait un bateau fantôme approchant silencieusement avec sa cargaison de malheur et de maladies.
L’eau était immobile, noire sous la nuit. Les milliers d’étoiles de la galaxie s’y reflétaient sagement, pas une certainement ne manquait. Moi que la mer nocturne avait toujours rebuté, dont je ne pouvais considérer sans angoisse l’étendue illimitée, répandue dans l’obscurité, incertaine, hostile même, voilà qu’elle me semblait offrir, après cette journée trop chaude, des membres frais, un ventre doux, des voiles soyeux et parfumés. Elle m' accueillait en amant désiré. Un bain de minuit ! Je réalisais enfin ce vieux rêve que je n’avais jamais fait, ce doux fantasme que je n’avais eu, et dont je me dis alors qu’il se révélait avec la force et la joie d’une révélation. Je m’avançai dans l’eau, m'offrant nu et solitaire à la nuit et à la mer pour des fiançailles à trois ! les étoiles du ciel et leurs reflets me reçurent en ondulant légèrement, drap de dessus et drap de dessous se refermant autour de moi, m’emportant vers le large. La marée était à son plus bas, et aucune vague, si ce n’est la mince lèvre que je soulevais devant moi en nageant n’en animait la surface. Je m’éloignai vers le large, dans un silence absolu, dans une eau dont la profondeur n’excédait pas ma taille, tiède et d’une transparence absolue, et dans laquelle je m’apparaissais pâle et ondoyant comme un poisson, comme une de ces molles méduses langoureuses et romantiques. Emergeant faiblement, une île apparut, banc de sable plutôt, que le faible niveau de la mer laissait affleurer, une de ces plages éphémères qu’ont voit apparaître lors des très basses marées au milieu des flots, territoires incertains, conquis deux fois l’an par des pêcheurs à pied , et dont on aperçoit au loin les silhouettes vacillantes que la lumière dévore. On les croit en perdition, mais dès que la mer reprend des forces, on les voit regagner sans hâte les rivages, portant des poches lourdes de coques, couronnés de fourches et de râteaux, l’eau jamais ne leur arrivant plus haut que les cuisses dans les passages les plus profonds. C’est dans ces environs que je nageais en cette nuit, me désintéressant pourtant des fruits de mer, n' aspirant qu' au large, fasciné par quelque chose que j’ignorais, attiré par je ne savais quel aimant, non pas sous la belle lumière de l’été, mais sous la non moins belle lumière de notre galaxie. Il n’y eut bientôt plus assez de fond pour continuer à nager, mes genoux rencontrant le sable grenu et je me mis debout, et pris pied sur la petite île.
Il n’y avait pas de lune, cette nuit-là, mais les étoiles brillaient suffisamment pour que le sable semblât phosphorescent. C’était la nouvelle lune, et ainsi que je l’avais appris récemment, cette lune-là brillait justement par son invisibilité: cette découverte m’avait déconcerté, j’y avais trouvé quelque chose de très contraire à ce que je croyais évident. J’avais ensuite compris, regardant des schémas simples d’astronomie comment il pouvait se faire que cette nouvelle lune soit déjà disparue. Me remémorant ces heureuses révélations, j’avais poursuivi ma trajectoire et j’étais presque déjà arrivé au centre de l’îlot. Il était occupé par une étendue de rochers noirs assez bas, de ceux qu’on voit souvent crever les plages blondes, dans les creux desquels les enfants pataugent, car ils y trouvent l’eau chaude et les crabes minuscules, les transparentes crevettes centimétriques, . Ils étaient recouverts de cette algue noire et caoutchouteuse, douce sous le pied, dont les larges lanières sont boursoufflées de belles vésicules verdâtres, gonflées d’un gel translucide et parfumé qu'il est si doux de faire jaillir, au parfum délicieusement apaisant, d’iode et de sel, parfum de la mer. Ces rochers formaient eux-mêmes, concentrique à l’anneau de sable qui les entourait, un disque dont le centre s’abaissait en un doux entonnoir aplati. Enfin au milieu d’un cercle où le sable clair réapparaissait, s’ouvrait un puits, un simple trou où l’on entendait l’eau tomber petitement comme au bas d’une gouttière. Cela rappelait en fait l’orifice central de certains animaux aquatiques, comme je l’avais découvert enfant dans un livre de sciences naturelles au collège. L’hydre d’eau douce, par exemple, ou la belle anémone de mer, possédaient ainsi cet organe, qui était à la fois une bouche et un anus. En était-il ainsi de l’étoile de mer , me demandai-je, car j’en remarquai quelques-unes parsemant les alentours, de l’orifice. M’approchant, je m’aperçus que c’était le départ d’un escalier, qui s’enfonçait dans le sable en colimaçon. Rien de surprenant, finalement que cela s’organise comme un coquillage, me dis-je, et pas plus que je n’avais hésité à me mettre en route au son flûté du batracien, je n’hésitai à m’engager dans le boyau. Les premières marches étaient puissamment taillées dans le socle de roche, juste sous la couche de sable blanc, et permettait une descente aisée. L’eau s’égouttait tout le long de la paroi, et sur les marches, en un joli murmure qui faisait croire par instants à des conciliabules gais, à des chuchotements féminins. Ce n’était que de l’eau claire. Quelques mètres plus bas, le granit céda la place à la brique : la paroi du tube et les marches furent minutieusement maçonnées dans un délicat appareil de petites briques, aux courbes douces et régulières, me rappelant ces cheminées d’usine qu’on voit encore parfois se dresser aux abords anciens des villes, et c’était comme si j’eusse voyagé à l’intérieur de l’une d' elles. L’assemblage des briques s’agrémentait de jeux de géométrie, comme on voit aussi sur ces cheminées et aux murs des vieux bâtiments qui les entourent, selon un procédé et une tradition de bon aloi, dont la rigueur m’aurait rassuré, si j’avais ressenti la moindre inquiétude. Cependant je ne m’inquiétais nullement: Ni de la durée, ni de la profondeur, ni du niveau des eaux, ni du but de cette descente tournoyante, enivré peut-être par son mouvement spiral.
Mais, un cri, un hurlement ignoble me terrassèrent tout à coup, me paralysant la jambe levée, en même temps qu’une calamiteuse explosion de lumière faisait voler en éclat le doux boyau, dispersait la ténébreuse nuit, faisait fuir à tire d’ailes les aimables étoiles, vaporisa la mer immense, les amoureuses qui toute la nuit m’avaient enveloppé de leurs caresses, et je me découvris enfin, tout ébloui, sur une plage inondée de soleil.
Je reconnus alors le sable désert de cette côte de Vendée, où je m’étais allongé il n’y avait pas une heure, et je me souvins que je venais tous les jours sur cette belle plage, depuis le début du mois , en cette fin d’été encore chaude, nager et dormir sous le soleil, la belle étoile.
Il me parut tout de même bien curieux d’avoir rêvé à tant de nuit sous tant de lumière. L’esprit, me dis-je est une bien vaste caverne. Au-dessus de moi une mouette rieuse passa, proférant à nouveau l’ignoble cri qui m’avait réveillé ♦

NOSTALGIQUE L' ETE
Par la fenêtre ouverte, le ronron d’une tondeuse à gazon est entré dans la chambre où il faisait la sieste, fatigué par la chaleur des premiers jours de juin. Mais il adore ce bruit qui lui rappelle son enfance, lorsqu’un voisin ou son père tondait la pelouse par une longue et ennuyeuse après-midi d’été. Des souvenirs de fraises, dévorées dans le jardin, de jeux avec ses amis, de fiévreux préparatifs de départ en vacances reviennent à sa mémoire; il se prête volontiers à la rêverie. La lancinante chanson de la machine, qui s’éloigne, revient, s’éloigne encore et semble disparaître pour revenir à nouveau, comme une abeille qu'on entendrait butiner de fleur en fleur, le berce doucement. Pourquoi n’est-il pas resté là-bas, léger adolescent pour toujours entre ses bons parents ? A-t-il rompu un sortilège ? Pourquoi se retrouve-t-il aujourd’hui, étudiant solitaire au bord d’une ville maussade, dans cette petite chambre universitaire ? Il se lève tout endormi encore et s’approche de la fenêtre, où la lumière violente l’éblouit. Au loin, par-delà le petit parc où la tondeuse zigzague sous des cèdres, les immeubles de la ville sont très pâles, bleu pâle, dans la lumière. Le parfum de l’herbe tondue lui saute au visage, et lui apporte d’un coup une autre bouffée de souvenirs . Bouleversé, il revient vers son lit. Il se revoit : il fait très chaud, même allongé dans l’herbe, à l’ombre de la haie. Dès ce matin, il a eu envie, le petit déjeuner juste avalé, de partir en vélo à l’aventure, comme un papillon, a-t-il dit à ses parents. Les petites routes de Vendée qu’il emprunte sont bien calmes, elles paressent de village en village, au milieu d'une campagne encore presque sauvage. Une heure seulement qu’il roule, par ces départementales et vicinales d’asphalte rose, où les bouses de vaches sont sèches depuis longtemps, et il a l’impression d’être plus loin qu’après une journée de voyage en voiture. Ces hameaux (qu'il a pourtant déjà vus), ces maisons, postées à des carrefours un peu solitaires, un peu bizarres, et dont il aime se dire qu'elles furent "relais de poste" , comme dans les romans, portant peut-être encore ces anneaux où on attachait les chevaux (il en a vu parfois), et qu' un ou deux pins, ou un if sombre, inhabituels en ce paysage, signalent déjà, et de loin, à l'attention, lui paraissent assez étrangers et il se sent déjà loin. Mais il a peu l’habitude du vélo, et bientôt il a envie de s'arrêter, de souffler un peu, un moment. Là, justement, un beau champ lui envoie à travers la haie de petits chênes, son parfum de foin fraîchement coupé, auquel il ne sut jamais résister. En escaladant la barrière, après avoir jeté son vélo contre la haie, il remarque, tressées dans les feuillages, des fleurs d’aubépine, ou d’églantine; leur parfum subtil appelle étrangement en lui l’image de cette fille, qu’il aime secrètement, au lycée, sage et mystérieuse; il regrette d’être seul et se rend compte combien il aimerait, en cet instant délicieux, être avec elle. Tout autour du champ, à l’ombre de la haie, on n'a pas fauché, et il se jette dans les hautes herbes; allongé, il se retrouve entouré d'un mur d'herbe frissonnante, au-dessus duquel des ombelles blanches sont doucement bercées. Mais, après ces longs efforts, il a chaud, et il ôte son tee-shirt. Il a dû, en marchant dans l'herbe , ou en s'y allongeant, écraser des menthes, ou quelque autre plante aux forts arômes de sauvagerie, car une verte et complexe odeur sophistique l'innocent parfum de foin coupé. Cédant à il ne sait quel caprice, une fois le torse nu, il a tout à coup envie de se déshabiller entièrement. Alors, se sachant à l'abri de tout regard étranger, il ôte le reste de ses vêtements. Allongé, dévêtu dans l’herbe, il se sent merveilleusement bien. Il se dit naïvement qu'il n'est finalement qu'un animal comme un autre, rien d'autre qu'une sorte d' oiseau, ou de lapin. Quelques confettis de soleil parsèment son corps, un vent léger court sur sa peau par moments, sur ses jambes, glisse sur son ventre, ses bras et tout cela lui est extraordinairement agréable: c'est comme si, se dit-il, la nature, le découvrait enfin, et le reconnaissait, ainsi que les parents reconnaissent leur enfant lorsqu'il vient au monde. Il a en fait l'impression de se découvrir lui-même, au moins, de se redécouvrir. Il se regarde, et s’étonne de sa pâleur, dans l’herbe si verte, de la tendresse de sa peau dans cette rustique nature; l' herbe, les insectes, les oiseaux lui semblent mieux armés que lui, pâle adolescent. Sur son ventre encore palpitant, un tout petit insecte aux élytres bleus et luisants s’est posé, et, précautionneux, s'aventure. Au dessus de lui, très haut dans le ciel, crie une buse; ses ailes largement écartées, paraissent fauves dans la lumière qui les traverse.
Une immense envie de douceur le prend, et pour la première fois, il désire une caresse, il rêve des mains d'une amie, s’il avait une amie, de cette fille, si cette fille l'aimait, glissant sur son corps. Comme ce serait merveilleux!
Et en cette après-midi de juin, le parfum du gazon tondu lui rappelle ce matin d’été, la découverte de lui-même, et le premier éveil de sa sensualité dans la merveilleuse senteur d’été. Il réveille en lui cet inépuisable besoin de tendresse qui, pense-t-il, est une délicieuse mélancolie et qui ne guérira jamais ♦
DANS LA RUE

BIZARRE QUAND MEME, CES CYCLISTES... rêve

Apparemment, ils préparent un spectacle, ces gens, ou tout au moins une performance, car pourquoi passeraient-ils et repasseraient-ils ainsi devant la maison, comme ils le font depuis quelques jours , sur ces étranges machines à pédales, grandes et légères et qui semblent devoir leur aspect à la fantaisie plutôt qu'à l'utilité, si ce n' est pour une sorte de répétition, profitant du calme de ce quartier souvent désert. Je les ai vus aussi un peu plus loin, au croisement de deux rues, quatre ou cinq autour d'une de leurs drôles de constructions de dentelle de fil de fer ou d'aluminium et dont ils semblaient discuter, entre eux, presque secrètement. Discrètement, c'est toujours discrètement qu'ils passent dans la rue, mais de notre premier étage nous les voyons bien et leur allure sur ou dans ces véhicules bizarres me rappelle toujours le vol fragile de ces insectes silencieux qu'on appelle "cousins" (cousins de qui, me demandé-je toujours, cousins des moustiques auxquels ils ressemblent mais en plus grand et en plus pacifique, cousins entre eux, ou cousins à nous?) qui souvent volètent, zigzaguent sans fin ou se traînent au sol comme des plumes dont se joue le vent le plus léger. Mais aujourd'hui, alors que nous passions l'après-midi au lit, sans aucun but érotique mais simplement parce que nous étions désoeuvrés et entre nous, ces gens ont sonné à notre porte et nous ont expliqué, gentiment, simplement et presque en s'excusant, pourquoi on les avait "vus sans doute passer, ces derniers temps dans la rue", sur leurs grands engins. Ils ont ajouté qu'ils se présenteraient bientôt à la population. Ils sont une petite dizaine d' hommes et de femmes, hommes en justaucorps noirs, femmes en tenues plus fantaisistes mais sans excentricité ♦ (octobre 2025)
SUBTILES SOUCIS, novembre 2025

Je les ai suivis un petit moment, j'étais en voiture, jusqu'à ce que nos chemins se séparent. Eux, en scooter, ils continuaient vers le centre-ville, père et fille, ou jeune couple, difficile à dire, casqués et protégés d'épais vêtements comme ils l' étaient. Les cheveux de la passagère flottaient doucement et elle portait sur le dos un étui à violon, noir, verni comme un piano à queue. Ils glissaient prudemment mais sans crainte pourtant entre les voitures, souplement comme une phrase musicale. Il était dix-neuf heures ce vendredi et j'ai pensé qu'ils allaient vers la salle de concert où dans quelques instants elle jouerait en compagnie d'autres violons, avec des flûtes, des bassons, des hautbois. L'homme portait par-dessus ses vêtements un gilet vert fluo flottant qu'il avait, j'imaginais et je l'approuvais, tenu à mettre, sagement, afin qu'on les voie bien et assurer leur sécurité. Quelle image émouvante que celle de ce couple doux - leur douceur s'exprimait dans leur course au fil des rues, dans cette chevelure doucement ondulant - en route à travers la circulation pour aller faire de la musique. Quel concerto brandebourgeois, quel poème symphonique, Schumann, Debussy? Je rêvais. La poésie, la musique, subtiles soucis, se glissaient ainsi prudemment mais confiantes, sûres et modestes, dans les mailles de la réalité et du quotidien, elles leur donnaient les couleurs du rêve ♦